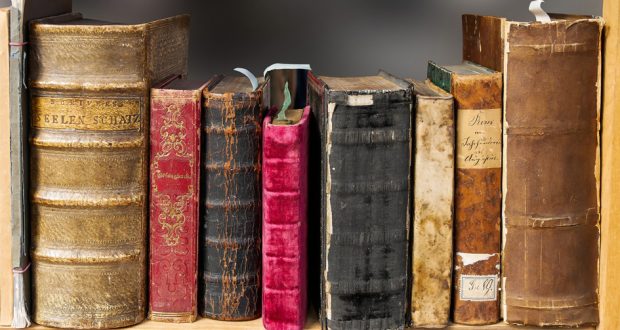MISSION EN TERRES BARBARESQUES
GENEVIÈVE CHAUVEL
Artège, 2025, 296 pages, 21,90 €
Voici une biographie particulièrement bienvenue du père Jean Le Vacher (1619-1683). Disciple de saint Vincent de Paul (1580-1660), il part pour Tunis en 1647 comme vicaire apostolique puis, à partir de 1676, il cumule cette charge avec celle de consul de France, d’abord à Tunis, puis à Alger, où il meurt martyr en 1683, attaché à la bouche d’un canon, au cours d’une guerre entre la Régence d’Alger et la France. Il passe sa vie à se dévouer aux esclaves chrétiens présents à Tunis et à Alger, tant sur le plan spirituel que matériel, favorisant par tous les moyens leur libération, tout en gardant de bons rapports avec les autorités turques locales.
Le récit de Geneviève Chauvel est particulièrement vivant, en particulier du fait du parti-pris par l’auteur d’y insérer des dialogues imaginaires entre les principaux protagonistes. De plus, elle porte une juste appréciation de l’attitude des autorités musulmanes, en ne cachant pas les maladresses de Duquesne et de Louis XIV lors du déclenchement du conflit qui aboutit au martyr du père Le Vacher. Puisse ce livre favoriser la réactivation du procès en canonisation de ce prêtre exceptionnel, ouvert en 1904 seulement et au point mort aujourd’hui.
Bruno Massy de La Chesneraye
L’ÂME DU GRÉGORIEN
Entretiens avec Louis-Marie Vigne
XAVIER ACCART
Cerf, 2025, 172 pages, 18 €
De la naissance d’une vocation à son épanouissement : telle est l’intention qui a inspiré à Xavier Accart, rédacteur en chef du magazine Prier, la réalisation de cet ouvrage dans lequel il relate l’édifiant parcours de son ami Louis-Marie Vigne (1953-2022), fondateur du Chœur grégorien de Paris (CGP). Tout a commencé pour ce dernier par la découverte du grégorien lors d’une retraite à l’abbaye de Solesmes (1971). Émerveillé par la grandeur de ce chant liturgique qui, malgré sa restauration un siècle auparavant par le bénédictin Dom Guéranger et sa consécration comme « chant propre de la liturgie romaine » par le concile Vatican II, s’éteignait alors un peu partout dans l’Église catholique, L.-M. Vigne entreprit d’œuvrer à sa promotion. Ainsi démarra « l’aventure d’une vie » conjuguée avec la profession de courtier en assurances.
Fondé en 1974 sous forme d’association, avec l’aide d’un proche de Solesmes, le CGP accompagna des messes dominicales dans plusieurs lieux parisiens, tels que l’église de l’hôpital du Val-de-Grâce (durant 35 ans), et dans l’ancienne abbaye de Fontfroide (près de Narbonne) pour tous les offices de la Semaine sainte. La formation des choristes revêtant une place essentielle dans le développement du CGP, L.-M. Vigne obtint d’enseigner le grégorien au Conservatoire de musique de Paris avant d’élargir son activité en créant, en 2006, l’École du CGP, à laquelle il donna très vite une dimension internationale, à la fois par l’accueil d’étudiants étrangers et par des tournées sur tous les continents, y compris dans la lointaine Asie. « L’estime que des croyants d’autres religions ont du chant grégorien devrait nous interdire de le négliger », confie-t-il en évoquant des expériences au Liban et au Maroc.
Au-delà du rappel de ses réalisations, L.-M. Vigne confie ses réflexions sur la valeur du chant grégorien dont « la pratique nous permet de retrouver une vie intérieure profondément libre ». L’ouvrage s’achève par un remarquable chapitre consacré à des commentaires sur les principaux épisodes de l’année liturgique. On peut dès lors saisir l’importance du travail accompli, telle qu’elle a été soulignée par Dom Jacques-Marie Guilmard, bénédictin de Solesmes, dans le Memoriam qu’il a publié lors du décès du fondateur du CGP : « Cette œuvre fait déjà partie de l’histoire de l’Église de notre pays. »
Annie Laurent
LES FINS DERNIERES
Eschatologie avec Thomas d’Aquin
PHILIPPE-MARIE MARGELIDON,
Saint-Léger Éditions, 2025, 158 pages, 14 €
Il faut le reconnaître, la catéchèse sur la mort, le jugement, l’enfer, le paradis, le purgatoire ou la résurrection de la chair, n’est plus très fréquente ; même « les traités d’eschatologie sont rares » comme le reconnaît le père Margelidon.
Cet effacement de l’eschatologie dans l’enseignement et même dans la littérature risque, sous prétexte de délicatesse pastorale, de devenir une infidélité au Christ et à Son Évangile car comme l’affirme notre auteur : « la révélation divine dit par mode d’images et de récits plusieurs choses qui concernent la fin de l’homme et du monde. Le donné scripturaire et de tradition est abondant. » En bon dominicain, le père Margelidon affirme que « ce donné, saint Thomas en fait non seulement l’inventaire, mais il en cherche le sens et en dégage le maximum d’intelligibilité ». À ceux qui affirmeraient que le propos du Docteur Angélique serait en la matière obsolète, le père Margelidon affirme que « si, çà et là, il convient de compléter, parfois de reformuler la doctrine thomasienne, […] l’ensemble de cette doctrine demeure pertinent et éclairant pour la foi ».
Notre auteur a le talent d’aller à l’essentiel par ce court traité (moins de 150 pages), d’aborder l’ensemble de la matière en quinze courts chapitres. La lecture est parfois exigeante mais toujours stimulante.
Au milieu de rappels utiles concernant la doctrine catholique sur les fins dernières à la lumière de l’enseignement de l’Aquinate, on découvre au fil des pages l’importance du corps dans la doctrine thomasienne. Le père Margelidon nous livre en particulier de très belles pages sur l’âme séparée, c’est-à-dire l’âme en attente de retrouver son corps après le jugement particulier. L’âme spirituelle en fut bien sûr « la fin, la raison d’être » de ce corps, mais « l’âme séparée désire, dans la béatitude céleste, d’un désir naturel, ontologique si l’on préfère, être unie à son corps pour être pleinement elle-même ». Après la Parousie, à l’heure de la résurrection de la chair, « par la puissance divine, l’âme, qui est le principe et la forme de son propre corps, ressaisit ce corps, c’est-à-dire le reconstitue, mais dans un état qui correspond à la gloire du monde nouveau ». Quel grand et beau mystère, quelle tristesse de ne pas en parler davantage !
Et à ceux qui s’étonnent que saint Thomas donne une grande place à l’enfer, notre auteur répond sobrement : « C’est que l’Écriture elle-même et la liturgie de l’Église soulignent fréquemment le risque de la perdition éternelle. »
Père Emmanuel Roberge
GÉOPOLITIQUE DE L’ORTHODOXIE
De Byzance à la guerre en Ukraine
JEAN-ARNAULT DERENSTallandier, 2025, 382 pages, 23,50 €
Selon que l’on recense ou non les Églises d’Orient, l’orthodoxie compte de 200 à 300 millions de fidèles, ce qui en fait la troisième confession chrétienne. Placée au carrefour d’empires disparus – celui de Byzance, dont l’imaginaire continue de la hanter, puis l’ottoman et le russe –, l’orthodoxie a été écartelée par la guerre froide. Après la chute du communisme, les Églises orthodoxes ont occupé le terrain spirituel, tout en se faisant le drapeau du nationalisme et le fervent défenseur des valeurs traditionnelles. Certes l’orthodoxie n’a pas été la cause, le prétexte ou même la victime des conflits qui déchirèrent le monde orthodoxe de l’ancienne Yougoslavie à l’Ukraine. Mais elle en a été souvent une actrice, en faisant figure de soutien des pouvoirs nationaux établis.
En portant un regard détaché, mais proche des réalités humaines, sociales, culturelles et religieuses qui constituent le substrat de la religion orthodoxe, Jean-Arnault Dérens, dans cet ouvrage d’envergure qui traverse les siècles et les contrées, permet au lecteur de sortir d’une vision « folklorisante » ou « orientaliste » dans laquelle s’est trop longtemps complu un Occident peu curieux. Il est vrai que l’orthodoxie, si divisée qu’elle soit, est obsédée par l’unité et garde la nostalgie d’un « âge d’or » qui n’a jamais existé, celui de la symbiose entre le pouvoir impérial et le pouvoir spirituel dans l’Empire byzantin. Ce qui explique aujourd’hui la tension entre Constantinople et Moscou. Les conséquences du Grand schisme de 1054 n’ont été surmontées que tardivement : les orthodoxes s’estimant être les gardiens de la juste doctrine, de la « voie droite » (orthos doxa). Il a fallu attendre 1964 pour que la levée des anathèmes soit décidée par le pape Paul VI et le patriarche Athenagoras, et 2016 pour que l’on assiste, dans les salons de l’aéroport de La Havane, à la rencontre historique entre le pape François et le patriarche Kirill. On prête au pape Léon XIV la volonté d’aboutir à un rapprochement entre le Vatican et le monde orthodoxe, ce qui nécessitera, entre autres, l’établissement de la paix en Ukraine. Une vision lointaine, qui nourrit l’espoir.
Eugène Berg
J’AI PORTÉ MA CROIX
SELMA H.Avec Odile Pruvot, Salvator, 2025, 140 pages, 16,50 €
ET DIEU M’A VISITÉE
Sr ANNICK MARIE ANTOINESalvator, 2025, 132 pages, 17,90 €
Ce sont deux récits bouleversants de converties de l’islam que publient les éditions Salvator. Leur différence : des contextes culturels et familiaux particuliers, des vocations diverses.
Pour Selma, née en France dans une famille d’origine algérienne, la vie est rude dès le début. Humiliée et mal aimée, y compris par sa mère, elle est réduite à endosser le rôle de servante au sein du foyer. Rien ne change lorsqu’avec les siens elle s’installe en Algérie. Contrainte par son père de se marier à deux reprises, elle devient mère d’une fille puis d’un garçon sans expérimenter l’amour conjugal. Ces épisodes révèlent les trafics et escroqueries divers, y compris financiers, qui entourent les traditions matrimoniales dans son milieu. Revenue en France, n’ayant cédé à aucune tentation de vengeance, Selma retrouve « l’ami extraordinaire » (le Christ en croix) découvert lors d’une visite imprévue dans une église alors qu’elle avait dix ans. S’ouvre alors son chemin vers le baptême.
Née en Côte d’Ivoire d’une mère chrétienne et d’un père musulman remarié avec une musulmane après son veuvage, Annick est élevée dans l’islam. Des enseignements troublants reçus lors des cours de religion, puis la découverte inattendue de l’Évangile, l’amènent à fréquenter le renouveau charismatique jusqu’à suivre une retraite où elle expérimente l’Esprit Saint et le repentir. Après son baptême, elle entre à la Communauté catholique Mère du divin Amour. « Je m’épanouissais totalement dans cette forme de vie communautaire qui alliait à la fois contemplation et mission », confie-t-elle. Cependant, atteinte d’une très grave maladie, elle se prépare à la mort. Mais une série d’événements surnaturels lui obtiennent une guérison totale et lui permettent de prononcer ses vœux lors d’une cérémonie à laquelle assiste son père. Bouleversé, celui-ci se convertit alors au christianisme. L’auteur termine son livre par de très beaux passages où elle confie son infinie reconnaissance pour les grâces obtenues lors de son parcours spirituel.
Des lectures à recommander en ces temps d’urgence évangélisatrice.
Annie Laurent
DOM AUGUSTIN GUILLERAND
Un maître spirituel pour notre temps
ANDRE RAVIER sj
Éditions Sainte-Madeleine, 2025, 476 pages, 25 €
Dans cette biographie (opportune réédition de 1965), très bien documentée à l’aide des nombreux témoignages de ses proches, des archives des Chartreux et de l’abondante correspondance qu’a écrite ce prêtre d’exception, l’auteur fournit une exposition très riche de ce qu’ont été sa vie, sa vocation, son esprit et sa haute spiritualité.
La première partie retrace avec précision, au plus près du cheminement intérieur, la vocation et le parcours de Dom Augustin Guillerand (1877-1945). Ayant grandi dans la Nièvre dans une famille profondément unie et chrétienne, il sera marqué à vie par cette terre et cet héritage familial. Ordonné prêtre diocésain, il mûrit son appel à la vie cartusienne jusqu’à rejoindre les chartreux, d’abord à la Valsainte puis en Italie. On découvre un prêtre qui, tout en restant très lié à sa famille grâce à une correspondance très dense, a toujours suivi le chemin que lui indiquait l’Église, au prix parfois de grands combats intérieurs, toujours vécus dans la fidélité au Christ et à son Église.
La seconde partie présente les pensées théologiques du père Guillerand ; après de courtes introductions, on découvre les fruits d’une contemplation de haut vol aux développements christologiques et trinitaires très fervents, sans oublier une grande dévotion mariale. Sa théologie est très marquée par l’Évangile selon saint Jean. Ses lignes, fruits de longues heures de prière silencieuse, nous font plonger dans le mystère de la vie trinitaire en offrant à notre méditation des pensées d’une très grande profondeur, dans le pur style chartreux.
Un ouvrage qui renseignera de façon précise sur cette très belle figure sacerdotale, au tempérament sensible et déterminé, qui a traversé une époque difficile, marquée par la Seconde Guerre mondiale, dans une grande piété et fidélité. Cet ouvrage sera l’occasion d’une plongée heureuse dans la spiritualité cartusienne, à recommander notamment à des esprits contemplatifs.
Marc-Henri d’Ozouville
PIER GIORGIO FRASSATI
Toujours plus haut
PATRICK SBALCHIERO
Artège, 2025, 208 pages, 18,90 €
Opportune biographie de Pier Giorgio Frassati, à la veille de sa canonisation prévue le 7 septembre 2025 : il avait été béatifié en 1990 par le pape Jean-Paul II qui l’avait surnommé l’« homme des huit béatitudes ».
Né à Turin dans une famille aisée, Pier Giorgio (1901-1925) était un jeune catholique italien et a consacré sa vie à aider les pauvres et à défendre les valeurs chrétiennes.
Profondément engagé dans l’action sociale et politique, il croyait fermement en la justice et en l’égalité, et il voyait la charité non seulement comme une aide immédiate aux pauvres, mais aussi comme un moyen de transformer la société. Il est actif au sein du Parti Populaire Italien, fondé par Don Luigi Sturzo, s’inspirant de la doctrine sociale de l’Église catholique et visant à réintégrer les catholiques dans la vie politique italienne après une longue période d’éclipse.
Membre du tiers-ordre dominicain, joyeux compagnon et irrésistible chef d’une bande d’amis, passionné d’alpinisme, il voyait la montagne comme un lieu de rencontre avec Dieu.
Il visitait régulièrement les quartiers pauvres de Turin, apportant nourriture, vêtements et réconfort aux familles dans le besoin et où il contracta probablement la poliomyélite foudroyante qui l’emporta. Il est décédé à seulement 24 ans. Son enterrement a révélé l’ampleur de son action caritative, par la présence inattendue d’une foule de personnes qu’il avait aidées.
Anne-Françoise Thès
Sur Frassati et Carlo Acutis (1991-2006) qui sera canonisé aussi le 7 septembre 2025 à Rome, signalons également :
- Les derniers jours de Pier Giorgio Frassati, Luciana Frassati, Téqui, 2025, 158 pages, 14,90 € : par sa sœur qui raconte ses six derniers jours.
- Pier Giorgio Frassati, l’audace de la sainteté, Charles Desjobert, Cerf, 2025, 142 pages, 15 € : sur sa spiritualité.
- Pier Giorgio Frassati, Bénédicte Delelis, Emmanuel Jeunesse, 2025, 204 pages, 13,90 € : une biographie accessible aux ados (et aussi du même auteur sur Carlo Acutis).
- Carlo Acutis, une âme de feu, Marie et Jean-Baptiste Maillard, Artège, 2025, 304 pages, 19,90 € : la biographie la plus fouillée, la référence.
- Carlo Acutis, le Ciel au cœur, Jean-Luc Moens, Éditions Emmanuel, 2025, 160 pages, 13 €.
VIGNES, VINS ET ABBAYES
LES CAHIERS DE LAGRASSE 6
ASMVAL (Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur de l’Abbaye de Lagrasse),
2025, 230 pages, 35 €
Créée en 2005, l’ASMVAL a pour objet de soutenir la renaissance culturelle et patrimoniale de l’abbaye de Lagrasse. Elle nous offre ici un Cahier passionnant sur les relations entre la vigne et les monastères de la région Occitanie, l’un des plus vastes vignobles au monde, l’un de ceux dont la qualité s’est le plus accrue depuis quelques décennies (que l’on songe aux Corbières, par ex.). La vigne représente un art de vivre, elle est un marqueur de civilisation. Des auteurs prestigieux (le Père Abbé de Lagrasse, le père Margelidon, le père Odon, du Barroux, Jean Barbey, le général Paitier…) nous expliquent la civilisation du vin, la vigne et le monachisme, la spécificité de Lagrasse, le vin dans l’Évangile… et chez saint Thomas. Réjouissant !
C.G.
L’ANTIQUITÉ SELON GUILLAUME BUDÉ
À l’école d’un humaniste érudit
ROMAIN MENINI, LUIGI-ALBERTO SANCHI
Les Belles Lettres, 2025, 246 pages, 25,90 €
Qu’est-ce qu’un humaniste de la Renaissance ? Nous en avons une idée floue, que ce livre vient décaper et rafraîchir. Ce portrait de Guillaume Budé (1468-1540) explore les facettes du prince des humanistes, bien méconnu, dont la réflexion sur la transmission des écrits grecs et latins de l’Antiquité, la manière de les aborder à son époque, doit nous aider à nous situer nous-mêmes aujourd’hui par rapport à eux dans une Europe déboussolée. Ce volume ouvre tout le champ de la curiosité intellectuelle des humanistes opérant leur « révolution culturelle ». Des savants, mais dont le regard surplombant est un antidote à l’excès de spécialisation actuel, à la myopie des divers savoirs sur l’Antiquité, « une pensée de la convergence », particulièrement pour les rapports entre monde païen et christianisme.
Chrétien, Budé mit sa connaissance extraordinairement étendue du grec au service d’une meilleure intelligence des Écritures. Il scruta d’un œil sévère la Vulgate latine « considérée comme sacro-sainte », la confrontant au grec d’origine, et doutant même que saint Jérôme pût être l’auteur des erreurs : « Pour moi, je tiens comme sacro-saint le récit de Luc, qui, lui, a écrit en grec. » Il s’en prenait à l’ignorance des clercs (il fustigerait leur démission aujourd’hui, leur peur d’avancer le moindre mot grec dans l’homélie pour éclairer les textes). Sa familiarité avec les Pères de l’Église, notamment avec les « Cappadociens », saint Grégoire de Nazianze surtout, saint Basile le Grand (mis sous le boisseau dans les homélies) lui fit trouver un double modèle, ferveur religieuse et forte culture. Comme eux, il invite à reposer la question : « Que faire de l’héritage païen ? »
De cette forte « restitution », comme on disait à la Renaissance, de Guillaume Budé par les deux auteurs, on retiendra enfin qu’il ne sépara jamais l’érudition et la vie de la cité, lui qui créa avec François Ier le Collège de France, dans la cour duquel se voit sa statue.
Patrice Soler
FLAGRANT DÉNI
HÉLÈNE MACHELON
Éditions Le Dilettante, 2025, 224 pages, 18 €
« La douleur la surprit un soir alors qu’elle lisait sur son lit. » Juste avant son bac, Juliette, 17 ans, est prise de douleurs aiguës. À l’hôpital où sa mère la conduit en urgence, elle découvre qu’elle est enceinte et que le travail de l’accouchement est déjà commencé. Mais comment accouche-t-on quand on n’est pas enceinte ?
De la naissance d’un petit garçon caché dans les entrailles d’une adolescente en incapacité de l’accueillir au retour à la vie quotidienne, chaque membre de la famille va jouer sa partition, et particulièrement Agnès, la mère que cette jeune fille apparemment sans problème repousse. L’espérance chevillée au corps, elle saura à la fois respecter sa fille, l’accueillir dans ce qu’elle vit et la guider, particulièrement dans les deux mois qui suivront la naissance : des mois décisifs quand se pose la question de laisser ou non cet enfant à l’adoption.
C’est un très bref mais magnifique roman, extrêmement émouvant et profond, rempli d’humanité et écrit dans une très belle langue. Une exploration tout en sensibilité des ressorts de la maternité et des relations familiales. L’auteur use d’une écriture efficace, sans fioritures avec de très belles images, de très belles tournures de phrases. Les personnages sont bien campés et leur évolution est touchante. Toutes les questions sont abordées, y compris celles du regard des autres sur cette « fille mère » ou encore celle du père absent. Hélène Machelon livre ici un récit inspirant sur l’accueil de la vie, c’est un vrai coup de cœur.
Marie-Anne Chéron
© La Nef n° 383 Septembre 2025
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant