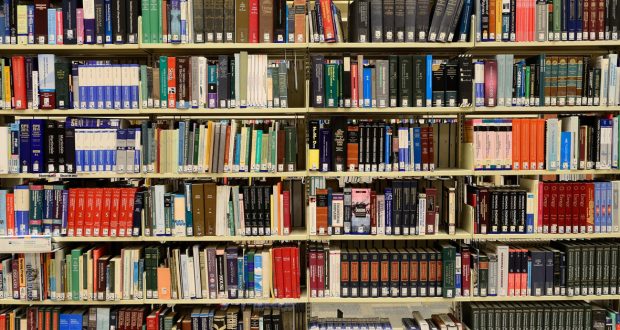DIEU EXISTE-T-IL ?
CARDINAL ROBERT SARAH
Fayard, 2025, 342 pages, 24,90€
Le cardinal Robert Sarah, au parcours ecclésial si riche, de l’enfance pauvre en Guinée-Conakry (il rappelle encore ici ce que sa famille et lui doivent aux missionnaires français) aux plus hautes responsabilités vaticanes, répond, dans ce nouveau livre d’entretiens, aux questions existentielles et métaphysiques de l’éditeur italien David Cantagalli. Ce dernier interroge le cardinal sur l’existence de Dieu, mais surtout sur son apparente absence et sur la grande objection à la foi : le scandale du mal dans le monde, et aussi dans l’Église. Au fil du texte, de nombreux thèmes comme la morale, les questions sociales et sociétales, la science et l’intelligence artificielle, sont abordées. L’entretien est mené par Cantagalli et paraît parfois un peu décousu ou répétitif ; mais, nous sommes toujours agréablement surpris par la profondeur, la variété et l’érudition des réponses du Cardinal. Ce dernier cite, dans le texte, et presque à chaque page, des trésors de l’Église de toute époque : des Écritures, en passant par les Pères de l’Église, jusqu’aux récents papes avec qui il a longuement travaillé. Mais il cite aussi, parmi tant d’autres, Péguy, Chesterton, Dostoïevski, Nietzsche, T.S. Eliot, Primo Levi, C.S. Lewis, Albert Camus et même Napoléon. La fin du livre reproduit un texte de Benoît XVI de 2019 sur l’Église et le scandale des abus sexuels. Ainsi, cet ouvrage constitue, en outre, une anthologie de textes forts pertinents sur la question de l’existence de Dieu et sur celle de l’Église. À lire d’une traite ou petit à petit, il nourrira avantageusement notre réflexion et notre vie spirituelle.
Abbé Étienne Masquelier
IL NOUS RESTE LA FOI
OLIVIER-THOMAS VENARD
Grasset, 2025, 234 pages, 20,90 €
Comment, lorsqu’on est chrétien, vit-on aujourd’hui à Jérusalem alors que la ville sainte subit les contrecoups de la guerre qui oppose Israéliens et Palestiniens autour de Gaza ? Telle est la réflexion que le père Olivier-Thomas Venard, dominicain français, chercheur et professeur à l’École biblique et archéologique de Jérusalem, où il réside depuis vingt-cinq ans, propose de faire partager à ses lecteurs.
De l’héritage reçu d’une famille catholique fervente et de ses diplômes (normalien, agrégé, docteur en lettres et en théologie), suivi de son engagement dans un ordre religieux marqué par saint Augustin et saint Thomas d’Aquin, puis complété par des apports exégétiques plus récents, l’auteur a appris à associer la foi et la raison. Et cela l’aide à fuir toute approche idéologique dans son regard sur les acteurs du conflit dont il est le témoin, sans pour autant l’aveugler sur leurs causes. S’agit-il d’une guerre opposant des religions, comme pourrait le laisser penser, par exemple, la rivalité bruyante et agitée des rites qui se partagent l’espace des lieux saints de Jérusalem ? Non, répond le P. Venard, « la première source du conflit israélo-palestinien est l’injustice plus que la religion », même si « les deux récits nationaux qui s’y opposent sont religieux en profondeur ». Mais cette approche relève plus de la sociologie, voire de l’idolâtrie, « contraire ou caricature de la religion qui consiste à adorer ce qui n’est pas Dieu », explique-t-il dans un passage substantiel.
L’essentiel de l’ouvrage concerne en fait la relation privilégiée entre le judaïsme et le christianisme (deux religions « construites en miroir ») qui caractérise l’histoire du salut, thème auquel l’auteur consacre des développements d’une profonde sagesse ; outre les enseignements de la Bible et de l’Église, il s’appuie pour cela sur son expérience de terrain, illustrée par ses échanges avec des interlocuteurs juifs et musulmans ou encore par son observation de la diversité des confessions chrétiennes. Évitant la tentation de donner des leçons ou de rejeter la légitimité du désir de comprendre certains choix politiques, son approche du dialogue interreligieux est teintée d’une lucidité nourrie par la foi qui décuple « l’appétit de connaître » l’autre et par l’espérance qui conduit à aimer « même des ennemis ».
Au-delà de la clarté intellectuelle de cet essai, il convient de souligner l’humilité du ton adopté par le P. Venard lorsqu’il avoue « le profond mal-être » que lui inspire le désastre actuel en Terre sainte, confidence qu’il tempère par cette certitude : « Mais il nous reste la foi ». Un livre qui mérite une grande attention.
Annie Laurent
VOYAGES DANS L’HISTOIRE DE FRANCE
15 grands récits de Louis XIV à nos jours
GUILLAUME PERRAULT
Tempus, 2025, 352 pages, 10 €
Allier sens du récit et recherche de la vérité historique, c’est l’ambition de Guillaume Perrault dans ce livre. L’auteur, journaliste au Figaro, a repris et étoffé une quinzaine de chroniques qu’il avait auparavant publiées dans le quotidien de droite sous forme de grands récits.
Les thèmes choisis sont relativement éclectiques et relèvent du champ de l’histoire politique (6 février 1934, accords de Munich), de l’histoire sociale (la médecine sous Louis XIV, les retraites des serviteurs de l’État), de l’histoire des idées politiques (l’antisémitisme de gauche, Raymond Aron), des relations extérieures (Bonaparte à Gaza), du portrait (Pompidou) ou encore des points chauds de l’histoire (les guerres de Vendée).
À la manière d’un Jean Sévillia dans Historiquement correct, Guillaume Perrault tente de restaurer l’histoire dans sa complexité en évitant de la juger à l’aune du présent, et pour cela, il recourt à la narration afin de limiter toute interprétation hâtive et toute idéologie : « La narration dissipe cette illusion rétrospective, permet de mesurer le brouillard qui entourait les contemporains et immunise contre le sentiment de supériorité qu’éprouve trop souvent celui qui connaît la suite ». Une méthode qu’il est allé chercher chez Alain Decaux à qui il rend hommage dans sa préface.
L’ensemble donne une suite de quinze récits, riches, synthétiques et très bien sourcés ainsi qu’un état de la recherche historiographique sur les questions encore en débat. Apparemment sans liens entre eux, ces thèmes sont étudiés avec le souci de ne jamais se placer en surplomb des événements commentés. C’est ainsi que les accords de Munich – peut-être la chronique la plus originale avec celle sur le 6 février 1934 – apparaissent sous un nouveau jour et l’image de Daladier n’est plus du tout celle d’un lâche.
Enfin, à travers Pompidou ou Raymond Aron, on sent que l’auteur admire les hommes qui allient rigueur intellectuelle et humilité devant le réel, loin de toute posture moralisatrice.
Benoît Dumoulin
L’OBÉISSANCE EN QUESTION
JEAN-PIERRE MAUGENDRE
Via Romana, 2025, 80 pages, 9 €
Jean-Pierre Maugendre aborde là un thème important dans le contexte ecclésial actuel. Il propose sur ce thème une approche doctrinale et historique bien faite, claire et concise, qui replace bien l’obéissance dans l’échelle des vertus, rappelant que l’obéissance est due à l’autorité qui tire sa légitimité de sa faculté à servir le bien commun. Rien à redire, l’auteur connaît ses classiques. Il s’aventure ensuite sur un terrain plus glissant, celui des limites de l’obéissance chrétienne. Certes, les limites qu’il pose sont justes (même si on regrette que l’auteur ignore « La vocation ecclésiale du théologien », texte de 1990 de la Congrégation pour la Doctrine de la foi qui éclaire singulièrement cette question délicate), l’Église n’est pas une caserne et l’obéissance ne peut être aveugle.
Mais quand il applique la doctrine développée à la situation présente en faisant de la dissidence de Mgr Lefebvre une juste désobéissance ou en cherchant à relativiser l’obéissance dans notre contexte de crise, on ne peut plus le suivre. D’abord parce qu’aucun des exemples historiques qu’il fournit ne correspond au cas particulier de Mgr Lefebvre, donc ne permet de le justifier a posteriori. Ensuite parce que sa désobéissance s’enracine dans un refus du Magistère ecclésial au prétexte qu’il aurait rompu avec la « Tradition », ce qui est hautement discutable et nullement démontré, Mgr Lefebvre et les siens en venant à se prétendre meilleurs interprètes de la Tradition que le pape et tout le collège épiscopal unanime, position de nature schismatique qui s’oppose à toute la Tradition. Enfin parce que cette désobéissance s’inscrit dans une clé de lecture des événements qui est totalement décalée avec la réalité : pour l’auteur, toute la crise dans l’Église est la conséquence du concile Vatican II et de la réforme liturgique, d’où la légitimité pour lui de s’y opposer ; or cette crise s’inscrit dans un contexte de déchristianisation radicale qui touche toutes les confessions chrétiennes ; et l’Église catholique résiste plutôt mieux que les autres confessions qui n’ont connu ni concile ni réforme liturgique : cherchez l’erreur !
Christophe Geffroy
L’EMPREINTE DE DIEU DANS LE MONDE QUANTIQUE
YVES DUPONT
Éditions Guy Tredaniel, 2025, 334 pages, 22 €
L’auteur de cet ouvrage, Yves Dupont, docteur en physique théorique, agrégé de physique et professeur en classes préparatoires, inscrit sa réflexion dans le prolongement du best-seller de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies : Dieu, la science, les preuves. Il centre son exposé sur l’infiniment petit, les particules élémentaires de la matière (électron, photon, quark, etc.) et le modèle physique qui représente leurs comportements : la physique quantique. Une bonne partie de l’ouvrage présente au lecteur non spécialiste un résumé des découvertes récentes dans ce domaine, et cela avec un réel effort pédagogique de vulgarisation : pas de formules mathématiques absconses, le moins possible de vocabulaire technique. Malgré tout, la lecture de l’ouvrage est exigeante pour quiconque n’a pas un bagage scientifique sérieux.
Quelle est la thèse principale de l’auteur ? Il nous expose d’abord plusieurs constats et découvertes récentes : l’intrication des particules élémentaires, phénomène qui semble échapper aux contraintes de l’espace-temps ; la description des particules par des entités purement mathématiques, les vecteurs d’état, exprimant une probabilité d’être dans un état donné pour une particule élémentaire ; l’impossibilité de connaître à la fois la position d’une particule et sa quantité de mouvement ; la prise de conscience que l’expérience scientifique ne peut nous faire connaître le réel en soi, mais uniquement ce que l’auteur appelle un réel empirique, c’est-à-dire le résultat de l’observation de l’interaction de l’entité à étudier avec l’appareillage de mesure. De tout ceci, l’auteur en déduit que le matérialisme devient difficilement défendable. Il va ensuite plus loin et pense qu’un Esprit omniscient informe en permanence la matière, par l’intermédiaire de ces fameux vecteurs d’état – que l’auteur appelle des anges quantiques ! – retrouvant ainsi les intuitions de la théologie chrétienne traditionnelle.
La démonstration, menée pas à pas, est brillante et rigoureuse. Je crains cependant qu’elle ne puisse convaincre que ceux qui le sont déjà. Un athée fera remarquer que l’Esprit omniscient d’Yves Dupont est un Dieu « bouche-trou », placé là, à la frontière entre ce que nous pouvons connaître du réel et de ce qui reste inconnaissable. Ceci dit, c’est certainement un ouvrage qui mérite d’être lu pour nourrir notre réflexion sur « l’empreinte de Dieu » dans ce monde.
Bruno Massy de La Chesneraye
UN CŒUR RÉVOLTÉ
NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA
Herodios, 2025, 176 pages, 18 €
Les éditions Herodios nous livrent un ultime trésor avec la publication d’Un Cœur révolté de Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), texte inédit en France, originellement paru en 1959. Le Gomez que l’on y rencontre est un peu différent de celui que l’on connaît et admire. On lit habituellement ce maître de l’aphorisme comme une abeille butine un jardin en fleurs. Ici, Gomez n’a pas fini de polir son instrument : le texte est composé d’une suite de propositions, regroupées en de courts paragraphes, réunis en une dizaine de « textos », l’ensemble se lisant de manière linéaire comme un traité philosophique. Certaines réflexions sont parfois absconses ; chargée de symboles, sa langue n’a pas encore atteint l’épure et la précision qui feront sa renommée.
Cela étant dit, ce livre a paradoxalement une plus grande longueur en bouche que les autres. Une fois passée la (légère) déception formelle, on en découvre le potentiel formidable. C’est que ne souffrant pas de la forme parcellaire des aphorismes, il s’appréhende d’autant mieux comme totalité : ce ne sont pas des pensées, mais la pensée de Gomez qui y est couchée. Et son propos est extrêmement ambitieux : il s’agit ni plus ni moins d’y ébaucher les contours d’un système réactionnaire (qui est une anti-idéologie), allant de l’anthropologie à la philosophie de l’histoire, en passant par Dieu, la conscience, les régimes politiques, la technique ou la mort. Parmi toutes les grandes idées qu’on y cueille, on retiendra sa conception de l’homme qui, quoique naturellement vorace, est dans les faits impuissance, et de la partition qui en découle entre ceux qui, refusant ces limites, entretiennent le rêve destructeur d’une perfection terrestre, et ceux qui, l’acceptant au contraire car sachant le Malin en son royaume ici-bas, apprennent à s’émerveiller des choses les plus simples. Quant à la démocratie, loin d’être un outil neutre, elle est une « religion anthropothéiste » et son athéisme « une théologie d’un dieu immanent ». Chaque homme se croit dieu, libre de choisir ses valeurs et de refaçonner le monde à souhait. D’où sa fascination pour la technique, outil qui permet le dépassement de ses entraves naturelles. Face à ces gesticulations se dresse avec tranquillité le réactionnaire, stèle comminatoire du Bien et du Beau parmi les décombres. « De nos jours, la rébellion est réactionnaire, ou n’est qu’une farce hypocrite et facile. »
Rémi Carlu
MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE
Un argumentaire raisonné pour un nouveau regard sur l’histoire de l’Église et des Évangiles
PIERRE PERRIER et BERNARD SCHERRER
L’Évangile du cœur, 2025, 654 pages, 32 €
Le 12 mai 2025, comme première audience publique de son pontificat, le pape Léon XIV recevait le Jubilé des Églises orientales ; occasion pour tous les chrétiens de se réjouir de la fraternité unissant dans la communion à Rome des Églises qui, jusqu’en Inde, tracent leurs origines jusqu’aux temps apostoliques. C’est depuis plusieurs décennies une passion pour l’une de ces communautés, l’Église chaldéenne catholique, qui anime Pierre Perrier, ingénieur de profession et historien amateur. Dans ce nouveau livre, le dernier en date d’une longue série, il expose à nouveau la théorie par laquelle il s’est fait connaître du petit monde des syriacisants, à contre-courant des opinions académiques. Pour Perrier, la Peshitta, version de la Bible en syriaque (le dialecte araméen standardisé par l’école d’Édesse), utilisée pour la liturgie de plusieurs Églises orientales, dont la Chaldéenne, mais aussi la Syro-Malabare et la Syriaque catholique, représenterait un héritage direct des Apôtres, et refléterait un enseignement oral délivré par ceux-ci. Pour défendre à nouveau cette thèse contre le consensus universitaire, qui fait quant à lui de la Peshitta un texte secondaire et très tardif (ve siècle) par rapport à l’original grec du Nouveau Testament, Pierre Perrier écrit cette fois en collaboration avec Bernard Scherrer, également acquis à l’hypothèse de la primauté syriaque.
L’ouvrage commence par une fresque historique très ambitieuse, remontant jusqu’aux temps sumériens, pour étayer une critique de la priorité, indue selon les auteurs, non seulement du texte grec des Évangiles mais aussi de la culture grecque en général, porteuse d’un primat de l’écrit qui se serait imposé au détriment de l’enseignement authentique des Apôtres ; les auteurs mobilisent les écrits de Marcel Jousse pour défendre une vision de la transmission orale permettant d’accéder, selon eux, à cette authenticité. Dans une seconde partie, on voit se développer un schéma de l’élaboration du texte des Évangiles sur une base linguistique et culturelle araméenne ; dans une troisième partie, enfin, les auteurs proposent un échantillon de passages évangéliques dont la lecture serait clarifiée par la clé interprétative qu’ils proposent. Ce livre, de plus de 650 pages, témoigne de la fascination et de l’intérêt très légitime que suscitent les traditions orientales, second poumon trop souvent oublié de l’Église universelle. La thèse centrale chère aux auteurs, ou maint point de détail, ne convaincront peut-être pas le monde universitaire ; mais si grâce à cet ouvrage, d’aucuns peuvent découvrir la richesse de ces traditions et y être sensibilisés, on ne peut que rendre grâce et saluer cette publication.
P. Charles-Antoine Folgieman
DIEU DANS L’ÂME
Présence et transcendance de Dieu dans la théologie de Réginald Garrigou-Lagrange
ABBÉ ARNAUD RENARD
Cerf, 2025, 592 pages, 42 €
Notre désir de prière et notre vie spirituelle se fondent sur la foi en la présence de Dieu au plus intime de nous-même. Où fonder et comment expliciter théologiquement cette vérité, pour mieux la contempler et mieux la vivre ? Dieu dans l’âme propose de parcourir ce chemin sur les traces d’un esprit puissant et original, quoique profondément traditionnel : le père Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964). Prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, l’abbé Arnaud Renard a choisi de travailler sur un aspect original et peu étudié encore de son œuvre : le père Garrigou, à l’image de son fondateur, était un grand théologien, mais aussi et surtout un vrai spirituel, dont le savoir nourrissait la contemplation.
L’ouvrage propose de parcourir avec le maître dominicain un chemin de découverte de la présence de Dieu dans notre âme : de la « présence d’immensité » du Créateur on remonte à sa « présence spéciale » dans les âmes par le don de la grâce sanctifiante. L’originalité de Garrigou est d’aller jusqu’à un dernier stade de présence, objet avant tout de contemplation, mais dont la lumière projetée sur notre âme y éclaire à nouveaux frais le mystère de l’inhabitation divine et trinitaire : à la « présence spéciale », il ajoute et oppose une « présence très spéciale », propre à l’âme humaine du Christ en raison de son union (hypostatique) à la personne du Verbe éternel. À ce dernier stade de présence, nous ne pouvons bien sûr pas prétendre ni participer : mais la contemplation de l’âme humaine du Christ (semblable à la nôtre hormis le péché) dans son union essentielle à la personne du Fils, peut éclairer les modalités de notre propre union – par la grâce sanctifiante et l’inhabitation trinitaire – et renouveler l’ardeur de nos cœurs pour entrer toujours plus avant dans cette présence.
Le mystère de l’union intime de Dieu à l’âme de ses créatures personnellement connues et aimées fut au cœur de l’enseignement du père Garrigou-Lagrange, mais aussi de sa vie. Retraçant en conclusion l’itinéraire spirituel du docteur romain, l’abbé Renard montre comment il traversa personnellement les étapes de vie spirituelle qu’il s’était employé à décrire et expliquer avec tant de rigueur théologique, pour devenir toujours plus semblable à l’enfant que le bon père redevint en quelque sorte, par une terrible maladie de l’esprit, durant les dernières années de sa vie.
Abbé Paul Roy
DICTIONNAIRE AMOUREUX DES CATHÉDRALES
PAULINE DE PRÉVAL
Plon, 2024, 656 pages, 28 €.
Les multiples entrées de cet excellent dictionnaire, érudit et passionnant, permettent de pénétrer l’histoire des cathédrales, de ces hommes inspirés qui les ont bâties, des légendes qui les accompagnent. Un travail admirable.
Simon Walter
Roman à signaler
LA RIVIÈRE AU CŒUR FROID
KEITH McCAFFERTY
Gallmeister, 2025, 480 pages, 25,90 €
Sean Stranahan et Martha Ettinger, shérif dans le Montana, sont confrontés à une énigme originale : des morts suspects en lien avec la disparition d’une malle ayant appartenu à Hemingway et contenant notamment un manuscrit inachevé. Comme toujours avec McCafferty, le dépaysement est assuré : laissez-vous emporter dans les grands espaces du Montana à la fin de l’hiver, et immerger dans l’atmosphère des passionnés de la pêche à la truite ; et vous en apprendrez beaucoup sur Hemingway, ce n’est pas le moindre charme de ce roman.
Simon Walter
© LA NEF n°382 Juillet-Août 2025
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant