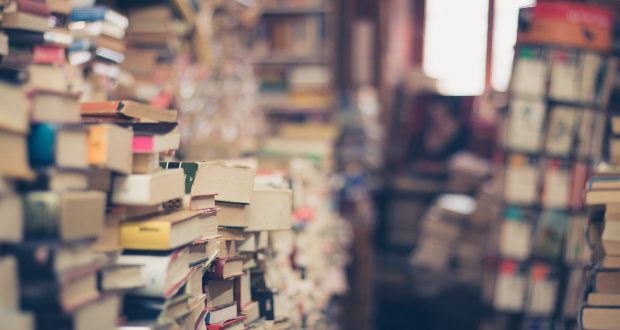L’EUCHARISTIE
Renouveler notre ferveur à la messe
JOËL GUIBERT
Artège, 2023, 314 pages, 18,90 €
Disons-le d’emblée : le nouveau livre du père Joël Guibert s’inscrit dans la lignée des précédents par une qualité que l’on retrouve dans son contenu comme dans son style, tout imprégnés d’une lumineuse pédagogie. Il s’agit ici de réhabiliter le sacrement de l’Eucharistie dans sa vérité et sa grandeur en remédiant aux ignorances, incompréhensions, ambiguïtés et déformations qui l’affectent trop souvent aujourd’hui, notamment dans sa double dimension : sacrificielle et rédemptrice. En trois parties (actualisation du sacrifice de la Croix, Eucharistie-présence et Eucharistie-communion), étayées par l’héritage des Pères et du Magistère de l’Église mais aussi par l’expérience de nombreux saints et auteurs spirituels, le père Guibert présente ce « grand mystère d’amour trinitaire » offert gratuitement par Dieu pour le salut des hommes. « Comment se fait-il que nous ne soyons pas bouleversés après chaque célébration eucharistique ? » s’étonne-t-il, invitant ses lecteurs à ne pas se tromper sur le sens de la messe, sur son lien intime avec l’Église, sur la centralité de la figure du prêtre et sur la fécondité missionnaire de la Croix. La présence réelle de Jésus dans l’hostie, opérée par la « transsubstantiation », doctrine immuable de l’Église catholique, fait de l’Eucharistie le sacrement de la foi, explique l’auteur, illustrant son enseignement par cette remarque sublime : « L’amour de Dieu se consume en nous en se laissant consommer par nous. » D’où son insistance à présenter l’adoration du Saint-Sacrement comme le complément de la communion. On trouve ici de précieux conseils pour une pratique réussie de cette intimité avec le Christ. C’est ainsi que se réalise le « sacrement de l’amour », capable d’éviter la transformation de la messe en une banale routine ou en un « simple repas fraternel ». À cet égard, il met justement en garde contre « un certain tourbillon liturgique, qui n’a rien à voir avec l’authentique participation active voulue par l’Église », celle-ci devant être comprise comme une « participation pieuse » qui consiste « à se livrer au Christ livré ». « Il n’y a rien de plus grand que l’Eucharistie », disait le saint curé d’Ars, et c’est bien pourquoi le diable et les forces du mal s’acharnent contre elle, observe aussi le père Guibert, dont l’ouvrage bienfaisant répond à un besoin crucial de notre temps.
Annie Laurent
UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA MESSE DANS LE RITE ROMAIN
UWE MICHAEL LANG
Desclée de Brouwer, 2023, 190 pages, 17 €
Oratorien de Londres et proche de la pensée de Benoît XVI, le Père Lang connaît bien la liturgie et nous offre là un excellent condensé de l’histoire de la messe dans le rite romain, depuis la Cène jusqu’à aujourd’hui, et ce dans un esprit ecclésial irréprochable. Ce panorama est présenté avec une belle hauteur de vue qui permet de bien saisir les évolutions essentielles pour mieux comprendre les débats passionnés qui se sont développés dans l’Église depuis la réforme controversée de Paul VI en 1969. Cette réforme, unique en son genre par l’ampleur et la rapidité des modifications apportées au rituel, marque-t-elle une rupture ou s’inscrit-elle dans une continuité homogène du rite romain ? Pour le Père Lang, qui a préalablement montré la vénérable ancienneté de l’essentiel du rituel romain, autrement dit de la messe dite à tort de saint Pie V, « les éléments de discontinuité et de rupture avec la tradition liturgique sont indéniables, qu’ils soient évalués positivement ou négativement ». Cependant, poursuit-il, « les études sur cette question, surtout dans les publications en ligne, ne tiennent pas suffisamment compte de l’histoire longue et complexe de la liturgie romaine. La trajectoire que nous avons suivie montre à la fois la continuité et le changement ». L’auteur fustige notamment l’approche aujourd’hui répandue qui voit un renouveau de la liturgie à la suite de Vatican II après un long déclin au Moyen Âge et une stagnation moderne, d’où l’idée de revenir au « développement dynamique » des premiers siècles. En citant le cardinal Ratzinger, le Père Lang met en garde : « L’archaïsme pur n’est pas la bonne solution et la modernisation pure encore moins. » Tous ceux que la question liturgique intéresse devraient lire ce petit essai qui aiderait grandement à mettre un peu de sagesse dans nos querelles liturgiques souvent trop passionnelles.
Christophe Geffroy
HISTOIRE POLITIQUE DES COLONNES INFERNALES
Avant et après le 9 Thermidor
JACQUES VILLEMAIN
Cerf, 2023, 528 pages, 35 €
Le titre est un peu trompeur. Il ne s’agit pas d’une histoire et l’auteur l’avoue lui-même. Cet ouvrage est d’abord une plaidoirie en faveur de la reconnaissance du génocide vendéen, même si cela n’est pas dit explicitement. Tout l’argumentaire cherche à démontrer en quoi il est impensable de nier le crime de masse qui s’est perpétré sur le sol français en 1793-1794.
Il y avait un mobile. La France révolutionnaire était entrée dans une guerre de religion contre l’Église catholique. Le culte de l’Être suprême devait s’imposer face à l’antique religion qui symbolisait l’Ancien Régime.
Il y avait anticipation. Jacques Villemain explique que l’entreprise des colonnes infernales n’était pas seulement le fait de quelques généraux en folie, mais bien d’une chaîne de commandement qui remontait au Comité de Salut public.
Il y avait bien l’intention d’exterminer toute la Vendée, y compris les patriotes vendéens. Le mot « brigand » ne signifiait pas, selon l’auteur, une manière de nommer une particularité qui faisait l’exception en Vendée, mais bien le Vendéen lui-même, de la même manière que Staline remplacera l’Ukrainien par le mot « bourgeois » lors de l’Holodomor.
Mais le débat demeure pour autant. Car les sources sont confondantes. D’une part, elles manquent, volontairement volatilisées à l’époque thermidorienne puis au XIXe siècle, quand il fut hors de question de victimiser la Vendée militaire. D’autre part, l’administration, l’exécutif et le militaire donnent des ordres qui restent implicites, souvent oraux.
Ce livre ajoute au débat historique sa teneur juridique en faveur du génocide. Les uns sont persuadés que le mot « génocide » est un anachronisme. Les autres veulent employer ce terme pour évoquer le massacre vendéen et faire reconnaître à la République son vice originel. Entre les deux, une ligne de crête, ceux qui veulent éteindre le débat en déclarant qu’il y a prescription. L’histoire du massacre vendéen et son historiographie ne sont pas près de se clore.
Pierre Mayrant
EXTENSION DU DOMAINE DU CAPITAL
JEAN-CLAUDE MICHÉA
Albin Michel, 2023, 270 pages, 20,90 €
Jean-Claude Michéa est un auteur sympathique toujours stimulant, un auteur de gauche comme nous aimerions en avoir plus, fidèle au vrai socialisme des origines, celui notamment de son maître George Orwell, autrement dit attaché à une défense politique et sociale des classes laborieuses et allergique aux réformes sociétales qui sont devenues le principal marqueur d’une gauche qui a abandonné le peuple. Ce nouvel ouvrage tourne autour d’un entretien de 2020 donné à Landemains, revue radicale gasconne, augmenté de « notes », puis de « notes de notes », forme d’écriture qu’il affectionne tout particulièrement. Avouons-le d’emblée, ce livre n’apporte rien d’essentiel aux précédents essais de Michéa dont la pensée anticapitaliste et antilibérale est bien mieux argumentée dans l’un de ses meilleurs livres, L’Empire du moindre mal (Climats, 2007). La critique de Michéa du capitalisme ou libéralisme (il ne distingue guère les deux dans cet essai) tels qu’ils apparaissent aujourd’hui est largement juste et donc utile, en ce qu’il dénonce un système – la financiarisation de l’économie – émancipé de toute limite où l’argent est un roi qui impose partout sa logique financière, jusque dans le sport. Fidèle à un certain marxisme, Michéa juge cette logique intrinsèque au capitalisme – c’est fort discutable – et il a tendance à ramener tous les maux à cette seule cause ; et surtout, on ne perçoit pas quelle alternative il suggère, car si on le suit quand il vante les mérites d’une vie plus saine, loin des écrans, au contact des réalités terriennes, on ne comprend pas bien quelle organisation de société il défend.
Christophe Geffroy
LA FACE CACHEE DES MOLLAHS
Le livre noir de la République islamique d’Iran
EMMANUEL RAZAVI
Cerf, 2024, 226 pages, 22 €
Voici un livre qui mérite une grande attention. Son auteur, journaliste expérimenté tant par sa fréquentation du terrain que par l’étude de textes méconnus et ses contacts avec nombre d’experts ou d’officiels, possédant de surcroît des racines iraniennes, y expose le résultat d’une enquête qui s’est étalée, non sans risques, sur plus d’une année. Il s’agit pour lui de montrer bien des aspects trop ignorés du régime qui s’est imposé à Téhéran depuis la révolution de 1979 menée par l’ayatollah Khomeyni contre le régime du Shah Mohamed Reza Pahlavi. Cette République islamique, fondée par les pasdarans (Gardiens de la révolution) qui en occupent tous les rouages, est « un monstre idéologique et mafieux », explique Emmanuel Razavi après avoir rappelé les circonstances qui ont conduit à une telle situation, monstre contre lequel se soulèvent aujourd’hui un nombre croissant d’Iraniens, pas seulement des femmes d’ailleurs. Bien que conçue par un pouvoir religieux chiite, cette idéologie s’inspire de celle des Frères musulmans, née en milieu arabo-sunnite au début du XXe siècle. Cela permet de comprendre le soutien de l’Iran au Hamas, détenteur du pouvoir à Gaza, et au Hezbollah libanais, dans le conflit qui oppose ces derniers à Israël. L’auteur décèle aussi une inspiration nazie dans la haine des Juifs qui motive la volonté des mollahs de rayer l’État hébreu de la surface du globe. Une partie importante de l’ouvrage concerne la « nébuleuse mafieuse » qui caractérise le régime iranien (corruption, mœurs dépravées, terrorisme d’État, production et trafic de drogue, blanchiment d’argent, trafic d’armes) dont la force s’appuie sur des alliances stratégiques mais aussi sur l’aveuglement, la faiblesse et la lâcheté de l’Occident. Tout en redoutant l’éclatement d’une grave crise régionale aux retombées internationales, Razavi juge inéluctable la chute de cette « tyrannie monstrueuse » car celle-ci « fait face à trop de crises, sur le plan intérieur, pour tenir encore longtemps ». Ses entretiens avec d’anciens collaborateurs du régime expatriés mais aussi avec le prince héritier Reza Pahlavi, rencontré à Paris en 2023, en train de rédiger une charte sur la transition politique, lui permettent de passer en revue les diverses hypothèses envisageables pour l’avenir. Redisons-le : il s’agit d’un ouvrage qui fera date.
Annie Laurent
LE JAPON. DES CHASSEURS-CUEILLEURS À HEIAN. -36 000 à l’an mille
LAURENT NESPOULOUS, PIERRE FRANÇOIS SOUYRI
Belin, 2023, 538 pages, 49 €
Voilà certainement l’ouvrage le plus complet en langue française sur la préhistoire et l’Antiquité japonaise (de l’apparition de l’homme dans l’archipel vers 34 000 av. J.-C. à l’an mille de notre ère). L’ouvrage s’appuie essentiellement sur les découvertes archéologiques faites par les savants japonais depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. On y découvre la naissance de la civilisation japonaise, caractérisée par une remarquable et précoce céramique (dès 14 000 ans av. J.-C.) et une agriculture beaucoup plus tardive (début du 1er millénaire av. J.-C.). L’ouvrage ne s’attarde pas à faire une critique historique des faits légendaires de l’histoire japonaise, mais insiste sur la description de l’émergence d’un État centralisé à partir du VIIe siècle ap. J.-C. qui finit par contrôler peu à peu tout l’archipel. L’aspect religieux n’a pas inspiré les auteurs qui ne lui consacrent que quelques pages concernant surtout l’arrivée et la progression du bouddhisme. Comme toujours pour les ouvrages de la collection « Mondes anciens », les illustrations sont remarquablement choisies et la cartographie impeccable.
Bruno Massy de La Chesneraye
SA VIE POUR LA MIENNE
JULIE GRAND
Artège, 2024, 176 pages, 16,90 €
En mars 2018, Julie Grand, prise en otage par un terroriste islamiste, fut sauvée par le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui offrit de prendre sa place et fut assassiné. Ce récit ne cache pas les douloureuses années qui s’ensuivirent, faites de souffrances psychologiques alourdies par le traitement kafkaïen des victimes par l’État, ses questionnements sans réponse, la lente dégradation collatérale de sa vie familiale. Pourtant, au bout de cette épreuve apparemment sans fin, une petite lumière surgit quelques années plus tard, sous la forme d’un courrier retrouvé par hasard d’un chanoine de l’abbaye de Lagrasse, père spirituel d’Arnaud Beltrame. C’est le début d’un nouveau chemin plus apaisé qui la mènera au baptême à Pâques 2023, avec cette certitude qu’elle doit sa conversion à celui à qui elle doit la vie. Un bel itinéraire.
Anne-Françoise Thès
DE LA BARBARIE ORDINAIRE
Essai sur le totalitarisme contemporain
PATRICE GUILLAMAUD
Éditions Kimé, 2024, 102 pages, 15 €
L’intérêt de cet ouvrage réside dans l’approche originale du mot totalitarisme. On retient d’ordinaire son acception historique, à travers l’expérience du nazisme et du communisme. L’auteur propose une définition anhistorique plus philosophique qui aurait comme avantage de coller à l’actualité française. Ainsi se plaît-il à définir les choses : « Toute idée est idéologique, toute idéologie est totale et toute totalité est totalitaire, à savoir dénégatrice du réel. Il n’y a pas d’une part la pensée et d’autre part le totalitarisme. C’est la pensée en tant que pensée qui est totalitarisme en tant que tel. » La définition a le mérite d’élargir le spectre.
Ainsi Emmanuel Macron garantirait, en tant que président de la République, un système totalitaire en France. Les dangers, les tentations idéologiques qui peuvent découler de l’état d’esprit français et plus largement occidental doivent-ils pour autant faire passer un mot pour un autre, en dépit de son entendement commun ? Le mot totalitarisme est tributaire d’une histoire et d’une lente maturation sémantique.
L’approche philosophique non assez ancrée dans les faits historiques convainc peu. Il est toujours difficile et audacieux d’utiliser un mot qui a servi à définir les pires barbaries du XXe siècle pour expliquer la nature d’un système qui, il est vrai s’en approche, mais dans lequel il fait tout de même mieux vivre. Si l’on pressent que la tyrannie d’aujourd’hui ressemble à certains égards à celle d’hier, ne faudrait-il cependant pas employer un autre mot ?
Pierre Mayrant
LA PERSONNE DU CHRIST ET LA VIE DU CHRÉTIEN
La morale liturgique de saint Léon le Grand
SERVAIS THOMAS PINCKAERS O.P.Academic Press Fribourg, 2023, 156 pages, 19 €
Cet ouvrage est une édition posthume d’un cours de théologie morale du père dominicain Servais Pinckaers. Il s’intéresse à la théologie du pape saint Léon le Grand et à celle déployée dans son sixième sermon sur la Nativité.
Au Ve siècle, le pape Léon avait à défendre la christologie orthodoxe face aux hérétiques. Il médite sur le mystère de la double nature, humaine et divine, de l’unique personne du Christ en lien avec la vie morale du chrétien, qui ne doit pas être autre chose qu’une contemplation et une imitation du mystère de l’Incarnation. L’auteur regrette, à l’heure actuelle, les trop grandes séparations entre dogme, morale, spiritualité, prière personnelle et liturgie communautaire. Chez les Pères de l’Église, et singulièrement chez saint Léon, ces domaines étaient unifiés.
Le livre présente d’abord la vie, le contexte historique et théologique, les grandes lignes de la pensée de saint Léon et son apport décisif au concile de Chalcédoine, sur la double nature du Christ. Dans une seconde partie, Servais Pinckaers commente de près le sixième sermon sur la Nativité. Enfin, la troisième partie unifie christologie et sotériologie. L’auteur, s’appuyant sur saint Léon et d’autres, en particulier saint Thomas d’Aquin, insiste sur l’importance de la double nature du Christ en une seule et unique personne. Le Verbe en prenant notre nature humaine, s’est uni et solidarisé à toute l’humanité. Le Christ subit la Passion et réalise l’offrande parfaite comme homme – inversant la geste d’Adam – et ce salut, acquis sur la Croix, se communique à tous, par le moyen de la grâce, parce qu’il est Dieu. Seule l’union totale dans l’unique personne du Christ permet de faire de la Croix le salut de tous. Ce livre roboratif donne à penser et lie notre vie de prière personnelle, la liturgie communautaire et la plus belle théologie patristique. Il nourrira avantageusement notre contemplation du mystère.
Abbé Étienne Masquelier
LA RACINE D’HABAQUQ
GAËTAN POISSON & PIERRE-ANDRÉ BIZIEN
Éditions Docteur angélique, 2023, 110 pages, 12 €
Gaëtan Poisson et Pierre-André Bizien nous proposent dans ce petit ouvrage un commentaire bienvenu sur un livre de l’Ancien Testament un peu négligé : le livre d’Habaquq. Ce livre reprend le thème du livre de Job, à savoir le mal qui frappe injustement, mais, alors que Job est rétabli, in fine, dans sa situation antérieure, car Dieu est juste, Habaquq, lui, anticipe ce rétablissement par un acte de confiance en Dieu. Le livre fait de nombreuses et pertinentes remarques sur le mystère du mal (tout particulièrement sur le fait que, pour Habaquq, Dieu n’est pas l’auteur du mal, comme l’affirme également le livre de Job). On lira avec profit, entre autres, le chapitre que Gaëtan Poisson consacre à la souffrance de la personne homosexuelle qui n’a pas choisi son état. Gaëtan Poisson, étant lui-même une personne homosexuelle fidèle à l’enseignement de l’Église, fait ici un éloge de la chasteté, suivi d’une condamnation de l’idolâtrie du corps et de l’idéologie LGBT qui ne manque ni de lucidité, ni de courage.
Bruno Massy de La Chesneraye
PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER… Conseils pour les premières années de mariage
PÈRE FRANÇOIS POTEZ
Mame, 2024, 236 pages, 15,90 €
« Aimez-vous, aimez-vous à la folie », voilà comment nous pourrions résumer les pages écrites par le père Potez. Cette invitation à l’amour patient et entier dans le mariage prend la forme originale d’une longue lettre adressée à Jules et Julie. Nous sommes à la veille de leur mariage, avant ce grand oui qu’ils vont échanger ; le père Potez prend la plume. Il couche sur le papier ce qui déborde de son cœur : une profonde gratitude pour les couples. Si certaines tournures ressemblent à celles d’un bon père soucieux pour ses enfants avant leur folle aventure, l’ensemble est ponctué de témoignages. Le propos nous mène sur le chemin de préparation d’un couple, Jules et Julie ou tant d’autres qui ont décidé de s’aimer.
« Puisque vous avez décidé de vous aimer… », tout est possible, voudrait nous dire le père Potez. Le mariage devient une aventure humaine, familiale, sociale et spirituelle sous la plume de ce fin accompagnateur. Il est toujours fascinant de lire un homme qui ne vit pas les réalités du mariage. Toutefois, il en connaît les grandes lignes, les vérités, les subtilités tant et tant il a discuté, rencontré, accompagné les couples, les fiancés, les hommes et les femmes désireux d’aimer en vérité.
Si ce ne sont pas des « conseils pour les premières années de mariage » comme l’indique la première de couverture, ces pages préparent au mariage. Le titre attire l’attention sur les conséquences de cet engagement aujourd’hui si décrié et critiqué. Page après page, nous découvrons une parole sûre et surtout bienveillante, se clôturant telle une ode à l’amour : « Et puisque vous avez décidé de vous aimer, aimez-vous, le reste, on s’en fout ! »
Anne-Catherine Jovanovic
LA CONFIRMATION À SA JUSTE PLACE
ABBÉ FRANÇOIS DEDIEU
Artège, 2024, 160 pages, 16,90 €
Comme l’indique le sous-titre, ce livre est « un plaidoyer pour proposer ce sacrement avant la première communion » et lui redonner ainsi cette juste place. Le livre de l’abbé Dedieu s’inscrit dans la continuité d’un mouvement amorcé depuis quelques années déjà. En mai 2015, Mgr Minnerath, alors évêque de Dijon, créait un certain étonnement en proposant dans ses orientations pastorales d’abaisser l’âge de réception de la confirmation, avec une volonté affirmée de retrouver l’ordre originel des sacrements : baptême, confirmation et eucharistie en son sommet. Puis Mgr Cattenoz, archevêque émérite d’Avignon, annonçait que dès la rentrée 2017 la préparation à la confirmation serait faite en classe de CE2.
L’enjeu spirituel est de taille. Est-il possible d’admettre que, selon les diocèses, 60 à 90 % des baptisés ne soient pas confirmés ? Parce qu’elle offre un surcroît de grâces, enrichit du don de l’Esprit, lie à l’Église et fortifie en vue de la mission, la confirmation ne doit pas être réservée à une élite. Elle ne doit pas non plus être un faire-valoir pastoral destiné à conserver dans les aumôneries le petit reste rescapé du catéchisme.
De manière fort argumentée, l’auteur propose une stimulante réflexion sur la cohérence des sacrements de l’initiation chrétienne, des pistes de discernement pour la préparation et la célébration de la confirmation. Un excellent livre qui remet ce sacrement à cette « juste place », reflet de celle de « l’Esprit Saint dans la vie de l’Église ».
Anne-Françoise Thès
PANDÉMIE, DROIT ET CULTES
GUILLAUME DRAGO, CHRISTOPHE EOCHE-DUVAL ET JOËL HAUTEBERT (dir.)
Mare & Martin, 2023, 150 pages, 15 €
Voici un ouvrage fort opportun invitant à la réflexion après l’épisode tragique de la pandémie de Covid-19. Les auteurs ici rassemblés, chacun spécialiste de sa partie, intervenaient lors d’un colloque et s’interrogeaient sur la facilité avec laquelle les libertés fondamentales ont été réduites par les pouvoirs publics, y compris la liberté de culte, et sur l’acceptation sans broncher de ces mesures de la part d’une grande majorité de nos concitoyens. Il ressort de ces études fouillées que l’état d’exception n’a pas respecté les règles du droit, ni dans l’objet de l’exception défini de façon très large, ni dans sa durée et cela sans discernement, le président de la République concentrant tous les pouvoirs en la matière.
Nos auteurs invitent à une réflexion urgente, ainsi Guillaume Drago : « L’adoption de ces législations attentatoires aux libertés fondamentales est le résultat de renoncements et de l’absence de contre-pouvoirs dans notre système constitutionnel. » On dessine ainsi « une société disciplinaire » qui alimente « une tentation totalitaire », « constituée d’un ensemble de pratiques et de discours au service d’une emprise toujours plus grande du pouvoir politique et d’une vision manichéenne et dogmatique. Cette tentation mobilise de nombreux aspects comme la peur, le mensonge, la propagande, la manipulation des chiffres et des images ou encore l’embrigadement des citoyens devenus agents de contrôle » (Cyrille Dounot).
Un ouvrage salutaire pour une réflexion urgente sur les menaces qui guettent nos libertés fondamentales.
Simon Walter
Roman à signaler
DANS LA MAISON DE MON PÈRE
JOSEPH O’CONNOR
Rivages, 2024, 432 pages, 23,90 €
Mgr Hugh O’Flaherty (1898-1963), prélat irlandais attaché au Saint-Siège, profita de sa position durant la Seconde Guerre mondiale pour organiser des filières d’évasion qui sauva des milliers de Juifs et de soldats anglo-américains des griffes des nazis. Un très beau film a rendu compte de cette action héroïque : La pourpre et le noir (1983), avec Grégory Peck. Ce magnifique roman de Joseph O’Connor narre, d’une façon romancée, une partie de l’épopée d’O’Flaherty. L’histoire commence en septembre 1943 quand les Allemands occupent Rome et imposent, par le chef de la Gestapo le SS Paul Hauptmann (le personnage réel s’appelait Herbert Kapler), un régime de terreur sur la ville éternelle. L’action se concentre à la vieille de Noël 1943 autour d’une mission durant laquelle le réseau monté par O’Flaherty doit transmettre d’importantes sommes d’argent pour extraire de Rome nombre de soldats alliés cachés en divers lieux de la ville. Au lieu d’une narration chronologique, l’auteur alterne des récits en direct avec des témoignages rendus par différents protagonistes après la guerre. Cela forme un ensemble passionnant et d’une belle épaisseur humaine, les personnages du « chœur » monté par O’Flaherty pour son action étant particulièrement soignés. L’auteur relate aussi à sa façon la conversion en prison, après-guerre, de Hauptmann que l’Irlandais alla visiter, après avoir exfiltré sa femme et ses deux enfants au moment de la retraite allemande (cette dernière s’était affirmée anti-nazie auprès du prêtre). Un beau livre à recommander avec néanmoins une petite réserve sur une scène bien inutile de deux pages présentant un Pie XII hystérique fustigeant la résistance d’O’Flaherty.
Christophe Geffroy
© LA NEF n° 369 Mai 2024, mis en ligne le 31 mai 2024
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant