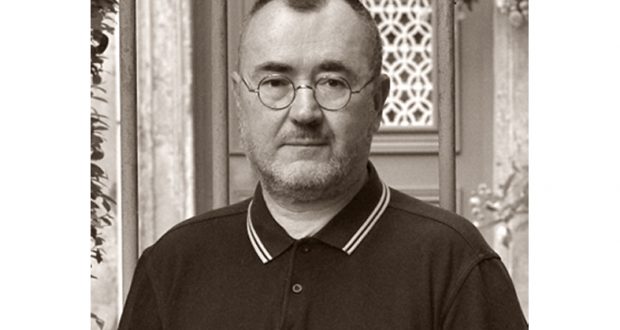François Huguenin a publié une somme sur l’histoire des idées politiques avec pour axe la tension entre l’individu et la société. Présentation.
La tension dialectique entre l’individu et la communauté est un axe structurant de l’histoire des idées politiques. Certaines sociétés feraient, en effet, primer la dimension collective de l’existence sur la singularité des individus, jusqu’à ne considérer ceux-ci que comme des rouages impersonnels d’un vaste projet collectif pouvant justifier toute forme de sacrifices personnels. D’autres, à l’inverse, estiment que la satisfaction infinie des revendications individuelles est l’horizon ultime d’une société ayant renoncé à proposer aux hommes un bien commun à partager et un projet collectif à mettre en œuvre. Entre ces deux écueils, l’équilibre se trouverait dans la pensée chrétienne contemporaine qui tente d’articuler l’existence d’un bien commun avec la nécessaire prise en compte de la liberté des personnes.
Telle est la thèse à partir de laquelle François Huguenin revisite l’histoire des idées politiques, en soutenant que cette tension entre le Je et le Nous serait la matrice de la pensée occidentale. Le propos est clair, l’argumentation est convaincante et les références extrêmement nombreuses. Comme toujours, Huguenin va puiser aux grands maîtres. Quand il analyse la pensée de saint Augustin, c’est Jean-Marie Salamito qu’il convoque, ce qui lui permet de dissiper tout contresens sur les prétendues visées théocratique de l’évêque d’Hippone. De même, pour comprendre la pensée des théoriciens du contrat social (Hobbes, Locke ou Rousseau), c’est Pierre Manent qu’il cite, notamment son Histoire intellectuelle du libéralisme (1998). Il en ressort un ouvrage extrêmement pédagogique, à la lecture facile, qui articule subtilement la pensée de chacun des auteurs autour de la dialectique entre l’individu et la société, ce qui en fait un produit original, à mi-chemin entre un manuel universitaire et un essai philosophique. De Platon à Ratzinger, en passant par tous les plus grands représentants de la pensée classique et moderne, le fil rouge est parfaitement tenu.
Si l’on suit l’auteur, on serait passé d’un monde classique où la communauté prime l’individu à un monde moderne où la société est au service de l’individu. Mais, rien n’est jamais aussi simple : « La modernité, marquée par la primauté de l’individu, n’a pas perdu toute notion du Nous, et l’histoire de la philosophie politique n’a pas attendu l’époque moderne pour prendre en compte le Je dans la quête d’un bien commun », notamment sous l’influence du christianisme.
Le chapitre le plus remarquable concerne sans nul doute celui dédié à la pensée de saint Thomas d’Aquin. Peut-être parce que l’Aquinate est celui qui articule le mieux la tension entre personne humaine et bien commun. Aussi parce que la présentation qui en est faite permet de mieux comprendre la subtilité de la pensée thomiste, à rebours de toute vision totalisante. Pour le Docteur Angélique, « l’homme n’est pas ordonné à la communauté politique selon sa personne tout entière »[1] car sa dimension surnaturelle à échappe au bien commun temporel pour communier dans le bien commun suprême qu’est Dieu Lui-même.
Une articulation que l’on retrouvera plus tard sous la plume de son disciple Jacques Maritain : « Ainsi charque personne individuelle, prise comme individu partie de la cité, est pour la cité, et doit au besoin sacrifier sa vie pour elle. Mais prise comme personne destinée à Dieu, la cité est pour elle, j’entends pour l’accession à la vie morale et spirituelle et aux biens divins, qui est la fin même de la personnalité ; et la cité n’a vraiment son bien commun que moyennant cet ordre »[2].
Ainsi, si dans l’ordre des moyens, le bien commun prime la personne humaine, c’est parce que dans l’ordre des fins, la personne humaine, dont la vocation est surnaturelle, prime le bien commun qui intègre en son sein le bien des parties et en est la garantie dans l’ordre politique. Dans ce contexte, l’homme n’est plus un rouage impersonnel d’un projet collectif qui lui échapperait et pourrait l’écraser ; il est acteur d’un bien commun qui contribue à son bien personnel.
Paradoxalement, c’est sous la période moderne que verra le jour une pensée totalitaire du Nous au sein de laquelle l’individu n’existe qu’en vue d’un projet social défini sans lui voire contre lui. C’est le cas avec Hobbes puis, de manière différente, avec Rousseau alors que dans les deux cas, il s’agit de philosophies qui reposent sur un postulat individualiste et envisagent la société comme une construction artificielle et volontaire de l’homme. Mais quand on supprime tout ancrage du bien commun dans la loi naturelle et la transcendance divine, on rompt l’équilibre qui maintenait ensemble personne humaine et société, ce qui engendre la tyrannie du Nous sur le Je et son contraire en retour.
Benoît Dumoulin
[1] St Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia IIae, question 21, article 4.
[2] Jacques Maritain, Trois réformateurs : Luther, Descartes, Rousseau, Plon, 1925.
François Huguenin : Le Je et le Nous. Une histoire de la pensée politique des origines à nos jours, Cerf, 2025, 448 pages, 25 €.
© LA NEF le 18 novembre 2025, exclusivité internet
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant