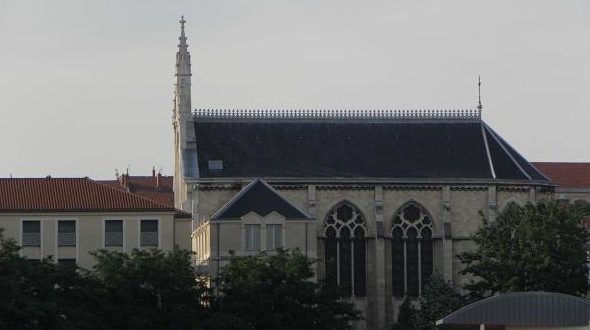L’enseignement catholique est-il libre d’être catholique ? Le nœud gordien a-t-il été tranché par Guillaume Prévost, secrétaire général de l’Enseignement catholique ? En réalité, tout ce débat est encadré par un certain état du droit, et par le statut des professeurs vis-à-vis de l’Etat, qu’il faut bien comprendre. Un autre enjeu réside dans l’affrontement d’un droit français de plus en plus restrictif, avec un droit européen plus libéral.
«Redonner clairement le droit à une enseignante de faire une prière le matin avec les élèves. » Cette simple petite phrase du nouveau secrétaire général de l’Enseignement catholique, Guillaume Prévost, a relancé le débat de la liberté des écoles catholiques d’être catholiques, débat utile mais complexe dans sa composante sémantique et juridique. Et ce pour plusieurs raisons. Les mots « neutralité », « laïcité », ou l’expression « liberté de conscience » font l’objet de définitions et d’interprétations tellement variées que leur application à des situations concrètes entraîne plus de confusion que de clarification. Ensuite, le contexte de la mise en œuvre de la loi Debré a considérablement évolué avec l’évolution de la société française, ce qui a conduit l’État à réaffirmer plus solennellement ses « valeurs républicaines » auxquelles les écoles catholiques sont sommées de se conformer. Enfin, l’accumulation des textes législatifs et règlementaires ainsi que l’articulation du droit français avec le droit européen ou international concernant la responsabilité parentale, la liberté de conscience de l’enseignant ou de l’enfant, aboutit à des contradictions ou, pour le moins, à des interprétations équivoques. Ces différentes dimensions constituent un nœud gordien d’une telle densité que l’on est tenté de le démêler à la façon d’Alexandre… ce qu’a fait Guillaume Prévost par une formule tranchante. Et c’est là que réside tout l’intérêt de son affirmation de bon sens, formulée d’une manière particulièrement rafraîchissante, car devant le procès fait aux écoles catholiques, elle semble nous dire, avec Mathieu 18-8 : « Au commencement (de la Loi Debré), il n’en était pas ainsi »… Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Plusieurs évolutions de fond l’expliquent. Nous en examinerons principalement trois.
1. Évolutions du concept de laïcité : la Constitution de 1958, en son article 1, dispose que « le principe de laïcité respecte toutes les croyances ». Mais cette approche ouverte de la laïcité a été progressivement réinterprétée dans un contexte de déchristianisation de la société française qui a coïncidé avec l’émergence de son islamisation et la création d’écoles privées musulmanes. C’est le motif pour lequel l’État a cru nécessaire de développer un corpus doctrinal appelé « valeurs de la République », ou « Charte de la laïcité » affichée dans les écoles publiques et privées, qui tend à substituer au seul respect des croyances une demande de « conformité » des croyances aux « valeurs de la République » – lesquelles ne coïncident pas toutes avec la morale chrétienne.
2. Évolution du contrat d’association : par évolutions successives, l’enseignement catholique a fait le choix d’une « publicisation » de son statut. D’une part avec la Loi Censi qui fait évoluer le statut des enseignants vers le statut « d’agent public de l’État » ayant les mêmes obligations que les autres agents du service public. D’autre part avec le secrétariat général de l’Enseignement catholique lui-même qui déclare dans un document paru en 2011, intitulé « L’établissement associé : l’autonomie au service de l’intérêt général » que l’enseignement catholique est en « délégation de service public ». On ne peut mieux consacrer le monopole de l’éducation par l’État et renforcer sa tutelle au détriment de celle de l’Église. On voit bien, dans les réactions des syndicats du privé et des autorités ministérielles aux propos de Guillaume Prévost sur « la prière en classe », ce que cette « sacralisation laïque » de la classe, autant dans son temps que dans son espace, doit à la conception laïque de l’école.
3. Sur la liberté de conscience : c’est sans doute sur ce point que le nœud gordien est le plus serré. Sa difficulté réside d’une part dans l’évolution d’une laïcité qui passe d’un droit à ne pas adhérer à une foi exposée à un droit de n’être pas exposé à cette foi, alors même que l’on a choisi une école catholique (1) ; d’autre part dans l’articulation entre le droit des parents, le droit des enseignants et le droit de l’enfant dans des contextes de références juridiques nationales et européennes qui divergent.
Devant les formulations de plus en plus restrictives du droit français ou de la conception de leur application, il semble que c’est du côté du droit européen que pourrait se trouver le salut des écoles catholiques en France. L’article 9 de la CESDH (2) dispose en effet que « toute personne a la liberté de pensée, de conscience et de religion […], ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Puis cet article ajoute, dans son alinéa 2 : « La liberté de manifester sa religion et ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Évoquer sa foi en classe, ou même avoir le désir de la partager, dans une école catholique, relève-t-il de ces restrictions ?
Christian Lecoq
(1) Contradiction exprimée par une autre formule savoureuse de Guillaume Prévost : « Va-ton dans un restaurant chinois pour commander une pizza ? »
(2) Convention européenne des droits de l’homme signée à Rome en 1950 sous l’égide du Conseil de l’Europe.
© La Nef n° 385 Novembre 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant