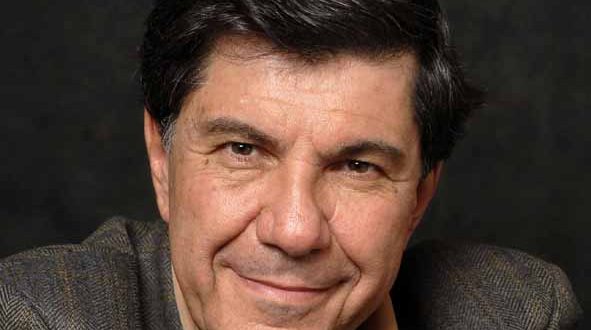La crise économique marque le déclin du modèle libéral anglo-saxon qui s’est imposé à l’échelle du monde depuis les années 1980. Explications.
Ce qui meurt devant nos yeux est le modèle économique voulu par les États-Unis depuis les années 1980, combinant la globalisation progressive de la finance déréglementée et l’imposition du libre-échange. De 1880 à 1929, le libre-échange favorisait les pays les plus développés. La productivité plus élevée de leurs productions industrielles leur permettait de pratiquer des prix plus avantageux, et cela même si le niveau des rémunérations pouvait être plus élevé que chez leurs concurrents moins développés. Aussi, ces derniers n’ont pu construire leur industrie que grâce à des protections douanières et une forte intervention de l’État.
Du libre-échange à la déflation salariale. Ceci a changé radicalement depuis les années 1980. Dans un système où les mouvements de capitaux sont libéralisés, ces derniers se déplacent rapidement vers un certain nombre de pays en voie de développement, qui ont accès aux techniques les plus modernes. La productivité du travail industriel connaît alors une hausse très rapide, qui n’est pas suivie par celle des salaires et de la protection sociale ou écologique. Ceci s’accompagne d’ailleurs d’une remontée en qualité de la production pour certains producteurs, la Chine en particulier, mais aussi la Corée et l’Inde (cf. tableau 1).

Tableau 1 – Indice de similarité des exportations avec les pays de l’OCDE. Évolution 1972-2005
Cette progression qualitative étend brutalement la concurrence des faibles salaires et faibles protections sociales de ces pays sur l’ensemble de l’appareil productif des pays développés. Telle est la base du phénomène de déflation salariale que nous avons connu depuis une quinzaine d’années. Sa forme la plus visible, les délocalisations, n’a pas été en réalité la plus importante. La pression à la baisse des salaires, au démantèlement des protections sociales et écologiques constitue l’élément majeur, fragilisant chaque jour un peu plus la majorité des populations des pays concernés. En même temps, l’impact du libre-échange sur les pays les plus pauvres a été sensiblement négatif. Si les premiers résultats publiés en 2003 claironnaient des gains de l’ordre de 800 milliards de dollars, chaque révision successive des modèles utilisés a conduit à un effondrement de ces estimations.
Le crédit fou, panacée illusoire à la déflation salariale. L’explosion du crédit qui a eu lieu aux États-Unis et s’est propagée en Europe, qui est à l’origine de la crise financière, trouve dans la déflation salariale sa raison d’être. La déflation salariale a ainsi conduit à l’explosion des compartiments les plus risqués du marché hypothécaire. De marginaux qu’ils étaient dans la période 1990-1999, ils sont devenus centraux, que ce soit pour l’émission de nouveaux prêts ou pour les profits des courtiers en hypothèques. Ainsi, en mars 2007, à la veille de la crise, la valeur des hypothèques Subprime était estimée à plus de 1300 milliards de dollars.
Ceci s’est fortement développé en raison d’une innovation financière, le Credit Default Swap ou CDS. Le CDS est un accord entre deux parties pour échanger un risque contre un revenu. Il est donc analogue à un contrat d’assurance, mais il peut être fourni par des entités financières qui ne sont pas des compagnies d’assurances, car il s’agit techniquement d’un instrument financier comparable à un contrat d’option. Il correspond à une titrisation d’un risque en dehors des cadres habituels des marchés d’assurance. L’explosion de ces instruments dérivés de crédit a été spectaculaire. D’un niveau pratiquement inexistant en 1998 on a atteint 1500 milliards en 2002, 8500 milliards en 2004, 17 000 milliards en 2005 et 34 500 milliards en 2006 et 46 000 milliards en 2007. Ceci représente près de 4 fois le PIB des États-Unis et représente une somme supérieure à l’addition des PIB de l’UE, des BRIC (Russie, Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud), du Japon, des États-Unis, du Canada et du Mexique.
La contagion de ce modèle en Europe s’est faite de manière différenciée, avec deux modèles assez distincts, ceux des pays où l’endettement des ménages et des entreprises est fort mais celui de l’État réduit, et ceux où l’endettement public est élevé mais l’endettement des ménages et des entreprises bien plus faible (cf. tableau 2).

Tableau 2 – Endettement comparé en % du PIB en 2006
Le plus endetté n’est pas celui qu’on croit, contrairement aux affirmations de notre Premier Ministre. Le « modèle » américain s’est étendu en Europe à travers ses clones comme la Grande-Bretagne, où la politique de Tony Blair a fragilisé les salariés, et en Espagne.
La responsabilité de l’euro. En fait, la croissance fut constamment plus faible dans la zone euro que dans les autres pays développés de l’OCDE, mais aussi en Europe hors zone euro (cf. tableau 3).

Tableau 3 – Taux de croissance du PIB à prix constants (moyenne par période)
On constate de plus une grande dispersion des taux de croissance à l’intérieur de la zone euro. De 2001 à 2007, trois des quatre pays ayant connu une forte croissance l’ont obtenue sur des bases tellement malsaines qu’ils font partie aujourd’hui des pays « malades » de la zone euro : la Grèce, l’Irlande et l’Espagne. Ces pays ont soit laissé se développer une bulle immobilière de grande ampleur (comme l’Irlande et l’Espagne), soit toléré un déficit budgétaire important ainsi qu’une large fraude fiscale pour redonner du revenu à leurs ménages (la Grèce).
Tous les pays qui, au contraire, ont « joué le jeu » de la politique économique imposée par la monnaie unique sans chercher à doper leur croissance par des artifices dangereux ont connu une croissance plus faible que la moyenne de la zone. La France n’a maintenu un taux de croissance peu différent de la moyenne de la zone euro que parce qu’elle a procédé à une politique budgétaire de stimulation de son économie. La rançon de cette croissance française qui fut supérieure à celle de l’Allemagne et de l’Italie a été son déficit budgétaire. Mais ceci était imposé à notre pays par sa démographie, très largement plus expansive que celle de ses voisins et en particulier l’Allemagne (cf. tableau 4).

Tableau 4 – Taux de croissance au sein de la zone euro
La diversité des rythmes de croissance entre les différents pays, que ce soit pour la période 1986-1996 ou pour la période 2001-2007, est particulièrement frappante. L’Allemagne a contracté de manière particulièrement forte sa demande privée. Il est clair que si tous les pays de la zone euro l’avaient imité et avaient contracté simultanément et dans de mêmes proportions leur demande privée intérieure, la croissance de la zone euro aurait été encore bien plus faible que ce qu’elle fut dans la période 2001-2007.
L’euro a ainsi eu un rôle néfaste sur la croissance des pays et il est donc venu ajouter ses effets négatifs à la crise générale que connaissait le capitalisme financiarisé. Mais cette crise a entraîné une explosion de la dette publique, soit pour chercher à solvabiliser les ménages (cas de l’Espagne et de la Grande-Bretagne) soit pour faire face aux problèmes des banques.
Fin de partie ? Aujourd’hui, il est clair que le niveau d’endettement public est devenu insupportable, du moins si l’on raisonne dans les cadres institutionnels de la zone euro. C’est ce qui produit la « crise de la dette », dont la Grèce est un cas extrême mais absolument pas atypique. Cette crise de la dette a conduit, depuis le second semestre de 2010, à la mise en place de politiques d’austérité aux effets ravageurs socialement (23 % de chômeurs en Espagne, 21 % en Grèce, 16 % au Portugal) mais aussi économiquement avec l’entrée en récession de quasiment tous les pays concernés, de la Grèce à l’Espagne en passant par l’Italie, la Belgique et la France.
On voit dès lors que nous sommes arrivés à un point de rupture. Cette économie en crise ne peut se perpétuer désormais qu’en imposant aux populations des sacrifices croissants pour le maintien de la financiarisation, du libre-échange et de la zone euro. Mais cette crise va immanquablement déboucher sur des crises politiques qui mettront en cause l’Europe telle que nous la connaissons. Il nous faut donc aujourd’hui non pas réinventer seulement l’Europe – si tant est que cela soit encore possible – mais l’économie tout entière.
Jacques Sapir
Directeur d’études à l’EHESS et Professeur associé à la Moskovskaya Shkola Ekonomiki, Jacques Sapir est l’auteur de nombreux ouvrages dont La démondialisation (Seuil, 2011) et Faut-il sortir de l’euro ? (Seuil, 2012).
© LA NEF n°235 Mars 2012
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant