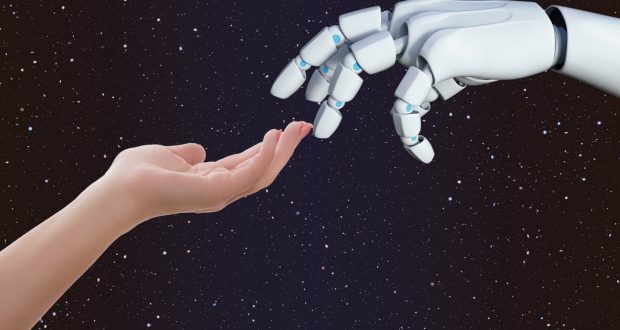La technique appliquée à l’homme est loin d’être éthiquement « neutre », le transhumanisme a donc une dimension morale qu’il est nécessaire d’interroger. Petit tour d’horizon.
S’agissant du transhumanisme, le questionnement éthique se pose de la manière suivante : est-il bon de faire ce que nous avons le pouvoir de faire grâce aux nouvelles technologies ? La technologie ouvre des possibles et l’éthique consiste justement à choisir entre ces possibles ceux qu’il est bon de mettre en œuvre et ceux auxquels il est bon de renoncer partiellement ou complètement. Il faut noter que la pression ambiante est très forte pour qu’aucun questionnement éthique ne soit appliqué aux nouvelles technologies. Il est d’ailleurs intéressant de noter au passage le curieux décalage entre l’importance de plus en plus grande que les États donnent au principe de précaution pour de nombreux comportements, souvent banals, de la vie humaine et sociale, et la non-application de ce même principe de précaution à des innovations technologiques qui peuvent avoir un impact jamais atteint jusqu’à ce jour sur la personne humaine et sur l’ensemble de la société. À bien y réfléchir, il y a là une disproportion vertigineuse.
Le questionnement éthique exprime l’enjeu majeur des nouvelles technologies et de leurs innovations, à savoir contribuer dans la réalité au bien de la personne humaine et de la société. Cet enjeu, parce qu’il est majeur, devient un défi à relever absolument. Ce défi, gigantesque, consiste dans le fait de discerner en quoi et jusqu’où une innovation technologique contribue réellement au bien de la personne humaine et plus largement de l’ensemble de la société. Ce discernement éthique devrait décider de l’usage ou non de l’innovation technologique. Et c’est là que nous sommes à un tournant de l’histoire de notre humanité.
Sommes-nous capables, dès maintenant et avant qu’un point de non-retour ne soit franchi, d’assumer le questionnement éthique au sujet des nouvelles technologies et de leurs innovations ? Il faut bien être conscient qu’à l’heure actuelle ce questionnement éthique « à la source » ou « avant coup » n’est pas acceptable pour la plupart des technoscientifiques. Au mieux, certains reconnaissent un questionnement éthique « après coup », c’est-à-dire une fois que la nouvelle technologie est déjà opérationnelle. L’expérience nous montre que le mouvement technologique est tellement rapide et puissant qu’il n’est pas possible de revenir en arrière. En effet, une fois que la technologie est opérationnelle, elle semble s’appliquer de manière irréversible, sans que personne n’y puisse plus rien. Même le Comité Consultatif National d’Éthique tend de plus en plus, dans ses avis, à réduire subtilement le questionnement éthique au simple examen de l’acceptabilité publique d’une demande sociétale, au point que l’éthique se réduit peu à peu à une légitimation de la demande sociétale, quelle qu’elle soit. Alors que l’éthique devrait réguler en amont, elle est de plus en plus réduite à légitimer et à régulariser en aval. Alors que l’éthique devrait donner un cadre pour éviter les dérives, elle donne l’impression de légitimer la dérive du cadre lui-même.
Du progrès à l’innovation
Il faut encore s’interroger : qu’est-ce à dire que depuis une trentaine d’années on parle de moins en moins de progrès et de plus en plus d’innovation, comme si l’innovation avait supplanté le progrès ? Pourtant le terme « progrès » dans son sens étymologique signifie le mouvement en avant de la civilisation, en général ou dans un de ses domaines particuliers, toutes sortes d’avancements et d’augmentations en bien. Dans le progrès est contenue la question de savoir si cela contribue à une amélioration, à un « plus » ou à un « mieux ». Quand on parle d’innovation, on veut simplement dire que quelque chose qui n’existait pas avant existe désormais, mais il n’y a plus d’évaluation qualitative, ni morale. La substitution de « progrès » par « innovation » viendrait-elle signifier que cette évaluation qualitative, morale, n’a plus lieu d’être et donc que l’innovation est acceptable en soi peu importe ce qu’elle innove ? Ne plus aborder la question du progrès revient à affirmer l’auto-référencement et la toute-puissance des technosciences : l’innovation est acceptable en soi, peu importe le contenu de cette innovation et son impact sur la personne humaine et la société.
La question du progrès humain et social est donc au cœur du questionnement éthique et du discernement à opérer au sujet des nouvelles technologies et de leurs innovations. Si cette question est la plupart du temps mise de côté, c’est par déficit de référentiel pour y répondre. Identifier ce qui est un progrès humain et social implique de savoir ce que sont l’être humain et sa vie en société. Le transhumanisme rend cette appréciation impossible en brouillant les frontières de l’humain. Jusqu’ici les frontières de la nature humaine étaient aisément repérables entre ce qui est humain et ce qui est inhumain. Nous étions habitués à déceler l’inhumain dans l’infra-humain. En effet, ce qui est inhumain pour nous, c’est d’abord ce qui se rapproche du bestial, de la cruauté sauvage des bêtes. Avec le transhumanisme, il faut s’habituer à déceler l’inhumain dans le surhumain, dans le transhumain. Ce n’est pas évident pour nous, étant donné notre tendance à dire que tout ce qui va vers le plus va vers le mieux.
En conséquence, dans ce contexte transhumaniste où la frontière anthropologique entre l’humain et l’inhumain a sauté, les nouvelles technologies ont le champ libre pour avancer sans contrainte. C’est pourquoi, seule une réaffirmation claire de ce qu’est la personne humaine permettra un authentique questionnement éthique sur le vrai bien apporté par les nouvelles technologies et leurs innovations aux humains et à l’ensemble de la société.
Dites-moi quelle est votre vision de l’homme et je vous dirai quel est votre projet de société. C’est là que nous devons absolument essayer de discerner sur quelle anthropologie se fondent les transhumanismes et quel projet de société ils préconisent.
Rejet de la transcendance
Le transhumanisme est une vision de l’homme, une philosophie, qui d’une certaine manière exprime un désir naturel, positif, profond et complexe, qui habite le cœur de tout homme : le désir de vivre et d’avoir des raisons de vivre, et le désir d’un dépassement dans l’intensité de la manière d’être et de vivre ici et maintenant. Au lieu de répondre à ce désir humain de « transhumaner » par la transcendance, le transhumanisme y répond par l’augmentation et la transformation technologique de l’homme, afin de le libérer de toutes les contraintes et finitudes de son état, de prolonger sa vie sur cette terre jusqu’à envisager qu’il puisse en définitive vaincre la mort. En cela le transhumanisme n’ouvre pas à la transcendance. Il enferme au contraire l’homme dans l’immanence de la matière au moyen de la technologie.
Nous devons avoir à l’esprit que l’avenir de l’homme, même celui qui se dessine au loin, se lit dans les projets de société qui sont portés par les philosophies, les idéologies et les religions. Quelle est l’intention profonde du transhumanisme et qu’est-ce que cette intention produira comme société lorsqu’il aura mis son programme à exécution ?
Deux humanités
Il faut savoir que le concept de « transhumanisme » a été forgé en 1957 par Julian Huxley qui fut le premier directeur général de l’Unesco à Paris et qui justifiait le transhumanisme de la manière suivante : « La qualité des personnes, et non la seule quantité, est ce que nous devons viser : par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d’un monde meilleur » (1). Le transhumanisme porte dans ses soubassements une volonté politique de réduire la croissance démographique pour préserver la qualité de vie de quelques-uns, autrement dit, un petit nombre au lieu d’un grand nombre, la qualité au lieu de la quantité. Le projet transhumaniste, en tout cas tel qu’il se donne à comprendre aujourd’hui, prône un homme augmenté, et l’homme augmenté ne sera pas celui qui est actuellement déficient intellectuellement ou démuni humainement, mais celui qui est aujourd’hui déjà un privilégié à tous niveaux, en particulier qui est capable de financer l’acquisition de la technologie. On peut penser que le transhumanisme porte en lui le projet d’une société divisée au moins en deux : d’un côté l’homme augmenté et, de l’autre, l’homme qui est aujourd’hui encore considéré comme « normal », même s’il est pauvre physiquement, psychiquement, intellectuellement, relationnellement, matériellement, mais qui demain ne sera même plus « normal » mais « diminué » car la tendance ira vers l’augmentation, même si elle ne pourra que rester marginale pour des raisons purement financières. Il y aura deux humanités, une augmentée et l’autre non augmentée.
Le transhumanisme est un athéisme et un athéisme jusqu’auboutiste. Nietzsche déclarait la mort de Dieu. Les transhumanistes vont encore plus loin en déclarant la mort de la mort. Nietzsche annonçait un surhomme, un Übermensch, habité par une volonté de puissance. Les transhumanistes vont encore plus loin en annonçant l’homme augmenté et transformé qui aura une puissance toujours croissante grâce à la technologie, jusqu’à chercher à vaincre la mort. Le transhumanisme comme tout athéisme veut se donner les moyens de réussir : remplacer Dieu par l’homme, par l’homme augmenté.
Lorsqu’on perd Dieu de vue, lorsqu’on perd le sens de Dieu, lorsqu’on cesse de contempler son mystère et sa volonté, cela a deux conséquences logiques : la perte du sens de la personne humaine et la perte du sens de la limite. En effet, quand on ne voit plus Dieu, on ne voit plus non plus celui que Dieu a créé à son image, à savoir la personne humaine.
Un athéisme et un matérialisme
Fondamentalement, le transhumanisme est un matérialisme. Il ne voit dans la personne humaine qu’une matière, qu’un corps. Il ne reconnaît dans ce corps ni la dimension de l’âme, à savoir ses facultés que sont la raison et la volonté, ni la dimension de l’esprit, qui est cette fine pointe de l’âme ouverte à la transcendance et donc à la relation à Dieu. Les transhumanistes réduisent l’intelligence au cerveau, et donc à un fonctionnement neuronal, certes complexe. Ils ne voient pas en l’intelligence humaine sa capacité de penser, c’est-à-dire d’induire, de déduire, d’analyser, de synthétiser, de mettre en relation des éléments qui n’ont en soi rien à voir entre eux, d’imaginer, de créer, d’inventer, de projeter, etc. Pour eux, l’intelligence artificielle n’est dès lors qu’une intelligence humaine augmentée, une intelligence humaine ++.
C’est une supercherie, car ce qui est appelé intelligence artificielle, n’est pas une intelligence au sens de l’intelligence humaine. En effet, l’intelligence dite artificielle n’est qu’une puissance de calcul, certes très rapide, plus rapide que l’intelligence humaine au point de donner à croire qu’elle va dépasser l’intelligence humaine. C’est là qu’est la supercherie : les transhumanistes donnent à croire que l’intelligence dite artificielle pourra se déployer indépendamment de l’intelligence humaine, alors qu’elle est au contraire complètement dépendante de l’intelligence humaine qui doit la programmer pour qu’elle puisse fonctionner. L’intelligence dite artificielle n’est pas capable de penser, elle est juste capable de calculer.
Il y a aussi la raison et la volonté. Là aussi les transhumanistes ne tiennent pas compte de la volonté humaine dont l’acte le plus beau est l’amour. Même la psychologie humaine ne semble pas intéresser les transhumanistes. Ils ne se posent guère la question de savoir si la psychologie de l’homme, que l’on sait fragile, va être capable de supporter l’intégration des nouvelles technologies dans son corps.
Le transhumanisme comme idéologie matérialiste se contente donc de considérer l’être humain comme une matière modifiable, améliorable, augmentable, transformable par la technologie, en particulier par les nanobiotechnologies et par l’intelligence artificielle. Dès lors, l’homme n’est plus protégé dans son identité et dans son intégrité, il devient une réalité manipulable et, ultimement, « machinable » par autrui. De plus, la robotisation de l’homme et l’humanisation du robot tendent à créer une confusion sur l’identité même de l’homme.
Enfin, le transhumanisme perd le sens de la limite. Les nouvelles technologies semblent être capables de repousser les limites à l’infini au point de faire croire que la limite ultime sur cette terre, à savoir la mort, pourrait être définitivement vaincue. Le transhumanisme, parce qu’il est un athéisme, ne peut pas accepter qu’une limite éthique soit mise à son agir, à son innovation technologique. Le refus de toute limite est tendanciellement la manifestation d’un choix, celui de la toute-puissance : d’une certaine manière, le transhumanisme se proclame maître de la vie, et juge souverain du bien et du mal, libre de toute limite, libre de toute morale ou éthique.
Tout cela est bien concret et actuel et nous ne devons pas succomber à la tentation, à laquelle pourtant nous succombons si fréquemment, d’en renvoyer la responsabilité à la génération de demain, c’est-à-dire à celle qui sera vraiment confrontée aux conséquences des non-discernements et des non-choix que nous ferions aujourd’hui, bien souvent en prétextant vouloir laisser le maximum de liberté à la génération suivante.
La grandeur de l’homme réside ultimement dans sa capacité d’aimer. Le premier antidote à cette fuite en avant du transhumanisme, c’est simplement de choisir d’aimer, de vivre toutes les relations humaines avec ce désir d’aimer. Quand l’amour habite notre vie, nous en mesurons la profondeur, la grandeur, l’éternité. Alors la mort ne nous fait plus peur, elle n’est qu’un passage vers la plénitude de ce que nous avons déjà goûté ici-bas.
Abbé Pascal-André Dumont
(1) Julian Huxley, New Bottles for New Wine, Chatto & Windus, Londres, 1957, p. 13-17.
L’abbé Pascal-André Dumont est économe général de la Communauté Saint-Martin, il préside la Sicav Proclero et le Conseil scientifique de Pro Persona. Ce texte, retravaillé pour l’occasion, est issu d’une intervention prononcée le 12 septembre 2017 dans le cadre des conférences Proclero.
© LA NEF n°312 Mars 2019
 La Nef Journal catholique indépendant
La Nef Journal catholique indépendant